De l’exil amoureux à l’écriture consolatrice
- bureau Nahei
- 1 avr. 2023
- 13 min de lecture
Dernière mise à jour : 4 août
Écrivains du Pacifique - Célestine Hitiura VAITE
par Daniel MARGUERON

De Faa’a vers de nouveaux horizons de vie
Originaire de la ville de Faa’a, Célestine Hitiura Vaite est née à Pape’ete en 1966 ; elle est d’abord institutrice, puis elle quitte la Polynésie en compagnie de son mari, le surfeur australien Michael Pitt, qui n’a pu obtenir de visa, pour s’installer à Mollymook en Nouvelle-Galles du Sud, où elle a vécu une trentaine d’années. Elle est mère de quatre enfants. Sur place, elle a animé des ateliers d’écriture, s’est occupée dans le cadre d’une association de femmes violentées et a beaucoup voyagé, suite à la publication et au succès de ses livres. Présente en Polynésie depuis novembre 2022, elle semble décidée à revenir vivre en Polynésie « mon fenua m’appelle » déclare-t-elle (1). Une nouvelle écriture de Célestine est sans doute en train de naître, en français cette fois, avec « l’histoire de notre maman… (2) » dans l’archipel des Tuamotu.
Peu avant les années 2000, ressentant une très forte et légitime nostalgie pour le Fenua, elle se met à écrire, notamment une nouvelle L’Électricien, qui est repérée, et encouragée elle rédige L’Arbre à pain, publié en anglais en 2000. Suivent Frangipanier en 2004 et Tiare en 2006. L’Arbre à pain est aujourd’hui traduit en dix-sept langues et diffusé dans vingt-cinq pays. Pour la Polynésie française, les trois tomes de ce roman familial ont été traduits en français par l’enseignant de la langue et de la culture anglaise Henri Theureau, retiré sur l’île de Rai’atea, et sont éditées par la maison tahitienne Au Vent des Îles. Depuis peu ses livres sont publiés en France dans une collection de poche (10/18).
Invitée au salon du livre de Pape’ete en 2002, 2006 et 2022, Célestine Hitiura Vaite est devenue, au fil des ans, l’écrivaine polynésienne la plus lue dans le monde. À Tahiti, elle a été, à deux reprises (2004 pour l’Arbre à pain et 2006 pour Frangipanier), lauréate du prix littéraire des étudiants de l’université. Frangipanier a été sélectionné pour les New South Premier’s Literary Awards ainsi que pour le Orange Prize et a été nominé pour les Baileys Women’s Prize for Fiction Best Book en 2006.
Revenue à Tahiti pour le salon du livre de novembre 2022, Célestine semble avoir choisi de demeurer dans son pays natal et d’y écrire en langue française, alors que la trilogie va devenir une série à la télévision.
Les cris de Célestine en faveur de l’écrit
Chaleureuse, déterminée et enthousiaste, telle se dévoile Célestine : mais qu’est-ce qui la fait courir ainsi ? Le bonheur contagieux de la réussite littéraire et sociale à faire partager, la colère (contre qui, contre quoi ?), l’urgence d’une relève culturelle et féminine dans la société, ou la volonté d’aider, d’encourager et de veiller sur les siens ? Deviendrait-elle une missionnaire de l’écriture, la passionnée Célestine ? Elle rayonne, et en particulier lors de ses interventions au dernier salon du livre de novembre 2022, où elle a animé des rencontres comme un show vivant, réactif et dynamique, avec une aisance totale, une affectivité et une sensibilité à fleur de peau, où les références à l’enfance, la famille, le pays et la langue natale perlent sa parole : « Nous avons besoin de vous » clame-t-elle, en s’adressant aux jeunes « elles sont belles nos histoires, écrivez, osez ! même si vous ne deviendrez jamais un écrivain publié ». Elle affirme, flatte et interpelle, prend à témoin son auditoire, réussit à le concerner, use de tous les langages articulés ou non, et d’un discours imagé en mettant en scène son propre corps comme une pièce à conviction. Un véritable spectacle vivant sur une scène : « Que ressentez-vous quand je dis : nous par nous ? Etes-vous d’accord de dire que nos histoires nous sommes les seuls à pouvoir les raconter avec authenticité (3) ? Sa parole de conviction, d’énergie, visiblement, doit se transformer et s’accomplir en action. Peu habitués à être sollicités de la sorte, certains jeunes s’approchent quand même du micro et approuvent ; l’un reconnait écrire un peu, l’autre confie avoir participé à un atelier d’écriture poétique avec une enseignante. En définitive, Célestine étonne, épate même littéralement les jeunes d’âge scolaire, guère familiers des interventions aussi explosives ou volcaniques !
Que deviendront dans l’avenir les exhortations et injonctions de Célestine auprès des lycéens ? Suffiront-elles pour que se concrétisent les pulsions d’écriture adolescente et que s’affirment des vocations ?

Le roman familial de Célestine Hitiura Vaite
Les trois romans de Célestine : l’Arbre à pain, Frangipanier et Tiare entrent dans la catégorie des roman familiaux. En effet ils répondent à la définition du genre, à savoir « le récit de l’évolution d’une famille (4) » sur une longue période ou plusieurs générations. Le roman familial « accorde une grande importance aux rites familiaux et à ce qui fait du clan une communauté… il connait des variantes diverses à issue négative ou positive ». Les trois romans de cette saga ont été publiés en Australie puis traduits dans de nombreuses langues de la planète. À Tahiti, la version française, publiée par les éditions Au vent des îles, est due au talent d’Henri Theureau.
Le dossier qui suit est composé d’une interview donnée par Célestine en décembre 2022, puis de deux articles, le premier de son traducteur ci-dessus nommé, Henri Theureau, le deuxième d’Henri Brillant Heinere, enseignant polynésien d’anglais, féru de littérature et de philosophie, aujourd’hui retraité.
Un roman comme refuge de la mythologie familiale ?
Initiée par une série de désordres familiaux, la saga s’interrompt à l’issue du troisième roman (et elle ne peut, littérairement parlant, être poursuivie), lorsqu’un nouvel ordre - toujours familial - se recompose progressivement et se met en place. Ces romans s’inscrivent dans la dynamique souhaitée par l’héroïne principale à partir d’une volonté de réussite sociale : constituer une famille normée, réussir à l’école en « poussant » les enfants, exprimer ses talents, connaître l’amour véritable, surmonter les obstacles de l’existence, être respecté et en sécurité affective, sortir de la pauvreté, enfin réussir sa vie. Sans la famille refuge, creuser collectif et façonneuse d’identité personnelle, il n’y a pas d’espoir ni de solution. C’est le contenu optimiste du récit, qui se bâtit comme une conquête menée à partir du courage d’une femme entrainante, Materena, autour de laquelle la vie communautaire se structure. La narratrice du récit manie l’humour pour ne pas juger ni blesser, ainsi que le comique des mots et des situations. Le récit familial s’appuie donc sur un discours positif et mutique. On n’aborde jamais frontalement un problème, on parle de choses qui paraissent insignifiantes, et pourtant tous les sujets de la vie, même les plus délicats, sont abordés voire traités. Ces romans appartiennent bien évidemment à la culture polynésienne dont ils sont issus, mais aussi plus généralement à la culture des pauvres (5), avec une question de fond : comment s’en sortir ? Materena ne se demande pas si la démarche est possible, elle met en œuvre, intuitivement, par capillarité sociale ou avec conscience et volontarisme, un ensemble de stratégies pour parvenir à ce but. Le roman se situe dans les années folles, agitées et violentes du CEP, qui marquent une rupture avec le monde d’avant qui représente aussi, soit dit en passant, le monde colonial. Materena comprend que la vie change, qu’il faut profiter des aubaines sans remettre en question la structure familiale, base de la société. Autant fiction que négation d’elle-même, entre témoignages et invention littéraire, les romans de Célestine ouvrent à une compréhension fine des années soixante-dix à quatre-vingt-dix, à travers les mentalités, les tabous, les difficultés et les rêves qu’un groupe humain peut vivre. À la question de savoir si ses livres sont autobiographiques, en 2003, Célestine déclarait au journal Les Nouvelles de Tahiti : « j’ai pris des petites histoires, je les ai trafiquées. J’ai joué avec les personnages », elle définit là le secret de sa fabrique littéraire, mais quelques phrases plus loin, elle reconnait s’être un peu autolimitée, eu égard à sa famille qui lirait son livre : « j’aimerais écrire des livres où je sors tout ». Pour l’instant, dans l’alcôve littéraire, la lumière reste allumée…

La culture populaire, un peu oubliée de nos jours, voire délaissée ou minorée, touche autant à l’humain et à l’universel que les cultures dites savantes. Célestine Hitiura Vaite en est l’un des témoins vivants.
Célestine par elle-même
En décembre 2022, quelques jours avant les fêtes, Célestine m’a donné rendez-vous pour notre entretien dans l’un des cafés de l’aéroport international de Tahiti-Faa’a, non loin de sa maison familiale ; et c’est dans ce lieu, où se croisent, se quittent ou se couronnent les voyageurs, d’ici et du monde, dans la joie, l’indifférence ou les pleurs, dans un brouhaha indescriptible de roulements de charriots, de valises, de colis de Noël à apporter d’urgence au fret, de musiques, d’enfants qui courent en tous sens, d’annonces diverses, d’écrans muraux où se décline la vie touristique des îles, c’est dans ce cadre-là que se déroule notre entretien.
« On se réveille tôt à Tahiti ! » s’exclame Célestine en arrivant au pas de charge, à l’heure dite, comme si elle achevait de se raconter intérieurement une histoire initiée avant le lever du jour ; et immédiatement elle coqueline avec talent, comme le font les mâles gallinacés au cœur de la nuit jusqu’au petit matin… Elle demande à son mari qui l’accompagne de l’attendre, lui confiant pour patienter le Tahiti infos du jour ! Il n’y a pas de préliminaires avec Célestine, on entre d’emblée au cœur de la rencontre, comme si la parole entre nous, initiée on ne sait plus ni où ni quand, pouvait se poursuivre désormais… Elle reçoit mes questions comme une gourmandise offerte, et danse sur elles, telle une virtuose, de manière toujours affable !
Je recherche auprès des jeunes que je rencontre la relève d’écrivains polynésiens. Parler de nous par nous, c’est ça. Je voudrais qu’ils racontent leurs propres histoires. Ma voix elle est bien, Chantal c’est bien, Titaua c’est bien aussi, mais on a besoin d’autres voix, c’est ma vision. Pendant mon enfance, Maman et mes tantes nous racontaient des histoires. Je suis entrée par la porte du rire et du vrai, j’ai toujours un côté positif. Oui, je suis une femme soleil, et l’écriture reflète la personnalité de l’écrivain. Je travaille depuis quinze ans avec un public de jeunes australiens. J’ai toujours été encouragée par ma famille.
Mes sources littéraires ? C’est d’abord Oliver Twist de Charles Dickens, livre que m’a offert une tante quand j’étais jeune, je l’ai lu, non en m’identifiant à la vie malheureuse du héros, que j’aurais vécu moi-même, mais dans le ressenti d’une empathie pour un personnage pauvre. Je reste très attaché à mon enfance, à ma grande famille étendue, à toutes les taties, à ma marraine. J’ai grandi dans l’amour du Seigneur et dans l’amour des ancêtres, je suis très religieuse, très spirituelle.
J’ai été aussi touchée par l’Âme des guerriers, d’Alan Duff avec la pauvreté, et la maman Beth qui souhaite une meilleure vie pour ses enfants. On écrit ce qu’on aime lire, c’est comme ça chez moi. Je n’aime pas les meurtres. Nous devenons ce que nous avons vécu dans notre enfance. Nous étions pauvres, mais j’ai toujours marché la tête haute.
J’écris sur mon peuple. Je n’écris pas et n’écrirai jamais sur l’Australie. Je ne parle pas des autres gens. Je n’aime pas trop quand un Européen écrit sur Tahiti. J’ai commencé à écrire quand un Australien avait écrit sur les émeutes de 1995 dans un quotidien, j’ai écrit une réponse de 1 000 mots au journal qui a publié ma lettre sans rien couper. Ma maison c’est une librairie, je lis les écrivains aborigènes ; quand un écrivain de là-bas écrit sur la misère, c’est bon.
Oui, l’écrivain est en mission, il y a plein de missions : s’exprimer, encourager, et ça demande des sacrifices d’écrire, la mission de ma vie c’est de donner envie aux Polynésiens de lire. Ma mère disait que lire permettait d’avoir un meilleur boulot.
J’ai déclaré à Polynésie la 1ère : « j’aime les histoires qui nous élèvent, qui donnent de l’espoir surtout à nos jeunes, je sais qu’il faut écrire des histoires « avii (6) », il y en a. D’abord c’est moi qui veux être élevée, j’aime donner de l’espoir. Chacun sa voix, chacun sa voie. Et je suis la plus lue des Polynésiens ! Dans ma famille je suis madame compliments, madame positive. L’histoire a des ailes, c’est vrai, sinon elles restent dans le tiroir ! L’histoire elle va visiter les gens dans les maisons, partout dans le monde, même dans la neige en Norvège !
Je me reconnais dans mon écriture, bien sûr ! Sinon je serai une étrangère, je me reconnais moi et toute ma famille. J’aime les fictions qui disent le vrai sinon, si ça sonne faux, je délaisse le livre ; en plus je ne peux pas écrire sur des personnes que je déteste. Mes personnages sont proches de mon univers. Ce qui me guide c’est l’amour le « aroha ». L’amour de mon pays. Être écrivain, c’est ouvrir les cœurs.
Pour qui écrire ? Pour soi-même et en même temps pour l’Arbre à pain c’était ma mère, Frangipanier ma fille et Tiare mon frère.
Quand j’écris, je sais ce que je vais écrire, et en même temps l’écriture me conduit, elle pousse l’histoire. On ne peut pas la mettre dans une cage. J’écris d’abord sur un petit carnet et j’attends les épiphanies, que ça vienne, après je laisse l’histoire respirer, puis je retourne avec un œil un peu plus critique. L’écriture me mène vers la fin de l’histoire. J’ai plein d’histoires à raconter, mais c’est l’histoire qui me choisit. L’important est de la terminer, c’est comme un collier qu’il faut achever. Après je la laisse voler… Ma famille ne m’a jamais reproché de délivrer des secrets, je savais que mon premier lecteur, ce serait ma famille, je me sentais libre et la famille depuis mon enfance m’a fait confiance. Ma mère m’a dit seulement : pas de blasphème dans tes livres. « Mamie, je lui ai répondu j’ai vu comment tu as élevé seule quatre enfants, et j’ai vu comment la foi te donnait de l’espoir ». Le fait d’écrire en Australie a fait que je me sentais en liberté. L’écriture ne m’a pas changée, j’ai toujours pensé à une écriture qui fait du bien. L’écriture m’a peut-être donné du pouvoir, du mana, mais dans la famille je suis toujours « Titine ». L’écriture m’a fait grandir. Je suis écrivaine mais aussi cuisinière, mère, maintenant grand-mère… La littérature n’est peut-être pas là pour réparer la société, mais pour rappeler la réalité, par exemple que Materena est née de père inconnu. Mais un livre peut changer la vie d’un lecteur.

Ce qui a changé dans mon regard sur mes romans ? Les personnages de mes trois livres je les regarde comme mes bébés. J’ai écrit ces livres à 29 ans, Materena allait avoir quarante ans, moi j’ai cinquante six ans maintenant, elle a toujours quarante ans. Ils ne changent pas. Je suis émue quand je pense à eux, ils sont venus dans ma vie comme un appel, et je remercie mes personnages de m’avoir choisie, je les aime. Ils vivent avec moi, ils sont plus réels que des personnages de romans. En les relisant, je les comprends un peu plus, ils ne vieillissent pas. C’est comme dans Une vie de Maupassant - c’est un de mes livres préférés du monde entier j’aurais voulu qu’il soit mon ancêtre -, je relis cette histoire une fois par an et Jeanne, l’héroïne, elle n’a pas vieilli elle est comme ma fille. Beaucoup de gens, notamment à la dédicace samedi dernier chez Klima, m’ont dit qu’ils relisaient mes livres ; quand un livre n’est pas figé dans le temps, dans le monde, il prend de la valeur. Mes livres ont vingt ans, oui, mais pour moi, la vie n’a pas changé à Tahiti vue dans le cadre de mes relations dans ma famille, mais quand je vais en ville, je vois beaucoup de jeunes et des magasins de luxe qui ne sont pas là pour nous.
Je parle un peu de tout dans mes romans, quand même de l’homosexualité féminine et des travestis, ma maman m’a dit : « oui ça arrive ! » L’autre jour au musée des îles où je suis allé écouter mon neveu l’orateur Tuariki Tehei pour la fête de Matari’i nia, j’ai vu deux filles qui s’embrassaient. C’était beau !
Je ne sais pas si je serais devenue écrivaine en restant à Tahiti ! En partant j’ai appris à aimer ma terre, et il faut beaucoup d’amour pour commencer à écrire, mais j’aurais fait quelque chose qui aurait été comme des livres. Dans ma première année d’institutrice j’ai écrit une histoire d’un père Noël qui portait des savates. J’ai toujours eu cette soif de quelque chose !
Tu me dis que je suis « un écrivain social, un écrivain populaire » au sens positif du terme parce que je mets « en scène le peuple, qu’il s’exprime comme il est et que je fais aimer le peuple tel qu’il est ». Je suis très reconnaissante du travail de traduction d’Henri Theureau qui est venu chez moi en Australie et avec lequel j’ai travaillé. On s’est retrouvés en novembre au salon du livre, ce fut un très bon moment.
Je n’ai pas de vision politique quand j’écris, peut-être un jour oui. Ce pays a besoin d’une femme pour prendre la relève. Donner une chance à une femme !
Retour au pays
Le retour au pays (après un exil, un long séjour -souvent pour études supérieures- en métropole ou à l’étranger) est devenu depuis le recueil du Martiniquais Aimé Césaire Cahier d’un retour au pays natal (1939), un passage difficile dans la vie et une antienne littéraire, associés à la prise de conscience d’un changement de la personne et souvent d’une situation humaine inégalitaire (à l’époque le racisme et le colonialisme). Il marque souvent un point de départ (affirmation de la négritude). Dans la littérature polynésienne, Albert Wendt a illustré cette problématique avec le roman Sons for the return Home (1973), dans lequel le personnage principal, un étudiant samoan, après une étape de sa vie en Nouvelle-Zélande, se sent étranger à son retour chez lui. Quant à l’ouvrage Je reviendrai à Tahiti de Ariirau, (L’Harmattan 2005), il appartient à cette veine, repensée dans le cadre personnel, culturel et historique local. De même dans le roman Tautai (Haere Pō 2011), l’auteur, Alec Ata, fait redécouvrir à l’issue d’une longue absence Tahiti à son héroïne, où elle ne reconnait plus rien, tant l’île a changé (rappel, en outre, de la troisième partie des Immémoriaux).
Célestine, de retour au fenua, est aujourd’hui à un tournant de sa vie littéraire. L’arbre à pain, Tiare et Frangipanier, on l’a compris, est une œuvre achevée et close. Si l’on considère la trilogie comme un ouvrage en trois tomes (les tribulations d’une même famille dans la durée), Célestine s’est maintenant attelée à écrire son second livre. Or, bien souvent, après le succès d’un premier, le lecteur comme la critique attendent le second qui sonne comme un défi difficile avec ses écueils : l’écrivaine trouvera-t-elle le souffle qui constituait l’originalité et le talent de la saga, Célestine saura-t-elle rester la même et/ou à la fois se renouveler, réinventer sa plume, d’autant que, cette fois-ci, elle écrit directement en français ? Traitera-t-elle, comme elle l’a annoncé, d’un membre exceptionnel de sa famille aujourd’hui décédé, évoquera-t-elle aussi le fenua redécouvert dans sa quotidienneté ?
Célestine, revenue au pays, s’est retirée, en ce début 2023, à Rangiroa pour écrire. Souhaitons-lui inspiration et réussite ! Ses nombreux lecteurs ont hâte de la lire, et de poursuivre avec elle, ce lien, ce chemin de vie !
1 - Entretien du 15 décembre 2022.
2 - Salon du livre 18 novembre 2022.
3 - Intervention au salon du livre le 18 novembre 2022.
4 - Le dictionnaire du littéraire, Yannick Preumont, PUF, 2004.
5 - Voir le livre Tahiti côté montagne (Cizeron/Hienly), éditions Haere po no Tahiti 1983, construit autour de la parole populaire recueillie auprès de quatre habitants de Papara par les deux auteurs, travailleurs sociaux.
6 - Traduction : qui font grincer des dents.

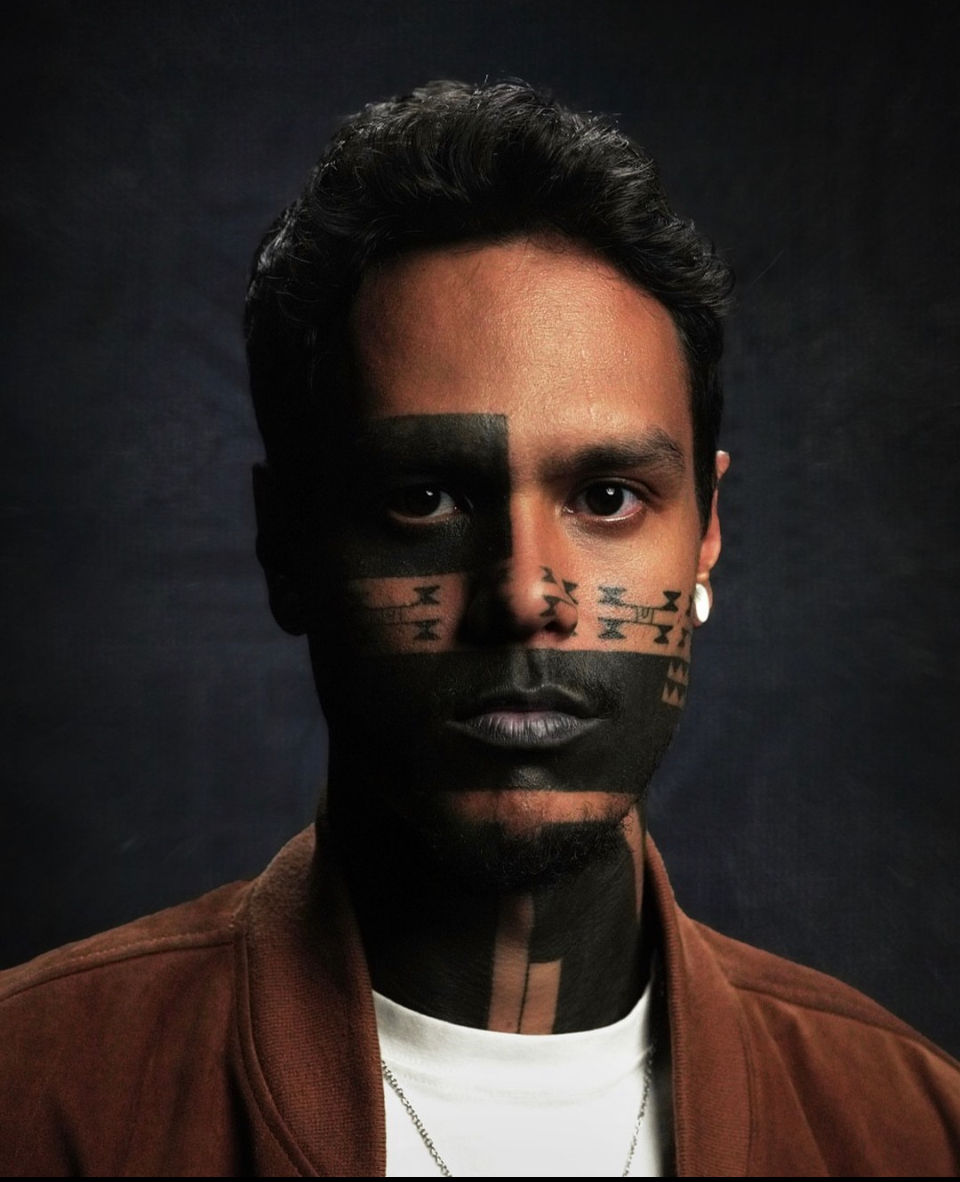

Commentaires