La trilogie de Célestine Hitiura VAITE
- 1 avr. 2023
- 14 min de lecture
Dernière mise à jour : 4 août 2025
Sous la loupe kaléidoscopique de Henri Brillant Heinere

Introduction
Les trois romans de la trilogie de l’autrice Célestine Hitiura Vaite (CHV), L’arbre à pain, Frangipanier et Tiare, me font penser à des recueils de nouvelles placées dans une chronologie événementielle bien rangée, à l’image de la parfaite « bonne à tout faire », expression anoblie par Materena (personnage central) en « ménagère professionnelle », et bizarrement et « bêtement » nommée aujourd’hui « technicienne de surface », perdant une profondeur sémiotique/sémantique pour l’aplatir superficiellement ! Le personnage ordinaire et extraordinaire de Matarena évoque une étoile fixement mobile de la narration, autour de laquelle tous les personnages virevoltent au gré des aléas émotionnels de la vie de ces petites gens qui subissent la sismographie météorologique des affects humains.
Le corpus textuel comico-tragique met en scène une famille nucléaire (parents-enfants) gentiment « frappadingue » de Faa’a (commune de Tahiti-ouest), qui va être secouée par moult situations d’existence variées dans une suite logique que lecteurs et lectrices (surtout) vont lire avec plaisir.
Le ressort comico-tragique « vix comica » ne pouvant venir que de l’« hubris » grec (la démesure), qui signifie le sérieux profond de la vie comme enjeu d’une extrême importance (surtout quand on fait des enfants), et non pas comme un « jeu » inconsistant qui va affaiblir les protagonistes, à l’image des « hommes irresponsables ». Il y a souvent de la démesure dans cette erreur tragique (Shakespeare : « out of joints », « hors des gonds ») qui aliène les personnages-objets et non plus sujets de leur devenir, piégés dans leurs faux combats pour les vices contre les vertus. Dans cette bulle d’angoisse mortifère, la seule sortie se trouve dans l’humour et le rire qui ventilent les émotions négatives (rage, colère, ressentiment), mais pouvant guérir, comme celles également de Rabelais, qui aurait peut-être aimé vivre à Tahiti. Gargantua et Pantagruel auraient apprécié l’appétit voracement « cannibale » des autochtones dans cette dramaturgie psychosomatique en plein air (« Teata taata ora », théâtre avec des êtres vivants), où les gens rient de leurs « conneries », mais en moins pinçés ou coinçés que l’humour « phlegmatique » anglo-britannique, humide comme les paysages arrosés par la pluie, la brume, la rosée du matin et l’alcool de ce pays.
Enfant polynésiano-tahitien à l’humour à toute épreuve, je riais de n’importe quoi, d’une feuille qui tombait bizarrement, d’un animal chien, chat, poulet, chèvre, qui se comportaient étrangement. Enfant et adolescent, j’ai vécu beaucoup de situations similaires à la vie familiale fictive de Matarena, à Paofa’i, quartier de mon adoption (« faamu » = « nourri ») jusqu’à l’âge de 15 ans par M. et Madame Buchin William et Raiti (Ahuura a Pere B.), avant de revenir habiter chez mes parents biologiques (M. Brillant Richard et Madame Retina Tetuanui B.). Dans mon quartier, beaucoup de voisins vivaient dans des maisons en pinex et tôles, avec encore quelques lampes à pétrole pour économiser l’électricité.
Quand l’éternel féminin tahitien s’appelle Matarena.
La vie de Matarena (protagoniste centrale des trois livres) me fait penser au film désopilant de la comédie italienne « Affreux, sales et méchants » (1970) d’Ettore Scola, mais en moins affreux, moins sale, et moins méchant, les Polynésiens étant par ailleurs très soucieux de leur douche nettoyante… Le bonheur simple de la famille « matarénéenne » ressemble au concept de sobriété heureuse de Pierre Rabhi, souvent utilisé aujourd’hui en politique et dans les médias, tout comme la notion de résilience (1). Les hommes, par exemple, s’enfuient pour laisser à leurs concubines ou épouses toutes les tâches domestiques éreintantes, les affaires du foyer, et même la responsabilité éducative et morale de leur progéniture. Ces femmes deviennent alors « hyper » résilientes dans leurs souffrances formatrices et très responsables, voire « très puissantes » dixit Matarena. Contrairement à leurs homologues masculins qui s’adonnent aux plaisirs de l’ivresse léthale, de la chair, ou de loisirs imbéciles d’adolescents en perte de maturation, tout addictes qu’ils sont devenus suite à leur insouciante et inconsciente dépendance à l’alcool (Hinano) et à la drogue des paradis artificiels (paka-cannabis), aux facultés d’oubli léthal, le cannabis tahitien étant très réputé et prisé dans la sphère des drogues.
La « forte vitale » des femmes : « mana » et réalité.
Le cœur à l’ouvrage de Matarena démontre une fois de plus la « force vitale » de la maman-épouse-amante polynésienne, une femme à « géométrie variable » ; et plus loin les hommes polynésiens (leur côté positif-participatif) acquis aux métiers très éprouvants d’ouvriers tous azimuts super exploités, et pour ne pas complètement succomber à la fatalité acceptée en partie, ils vont s’enfuir momentanément vers les paradis artificiels.
Dans ce fatum, on peut lire le vrai combat, celui de l’urgence de l’enjeu vital de tous les instants dans une psychopathologie freudienne du quotidien, « demain sera un autre jour », offrant un panel de projets à brève échéance (ce sera un semi-échec), réduisant l’effet de perspective constructive à la survie d’un jour dans l’autre. On est donc plus proche de la notion darwinienne de « survie des espèces » chantée par le poète-barde Reggae Bob Marley dans son « concrete jungle in Babylon », et malheureusement pas loin d’un parcours de SDF, sauf qu’ici, on a un « toit sur la tête », on « ramène des sous à la maison » pour « remplir le frigo », et habiller les enfants avant de les laisser à leur sort dans l’univers cognitif de l’école républicaine, où beaucoup d’entre eux n’iront pas très loin, surtout chez les garçons.

Il y a un climat d’entraide interfamiliale, interclanique, et intergénérationnelle, jusqu’au culte des anciens et ancêtres (« tupuna »), en plus de l’aide communautaire ou paroissiale de l’ensemble des religions. Tous ces soutiens représentent le ciment social qui permet à un être en désarroi ou en perdition de réintégrer un réel moins chargé en turpitudes, tergiversations, ou difficultés de toutes sortes.
Il y a tant de choses à dire sur la protagoniste principale Matarena, ainsi que sur la nébuleuse de personnages créés autour d’elle à son insu ou à son détriment, nous faisant voyager dans une intéressante forme de biographie ou autofiction en parallèle, où le lecteur se déguise en détective des mœurs et coutumes, ou même en ethnologue, ethnographe, anthropologue, sociologue, et psychanalyste à la Jerry Lewis, pour synthétiser en philosophe du temps perdu à retrouver, voire à reconstruire… En « ménagère professionnelle », Matarena aide, conseille, et forme surtout des femmes en réelle difficulté, faisant alors confiance à leur travail sérieux et respectueux des normes, d’une morale à toute épreuve, et de la politesse comportementale envers leurs employeuses-patronnes bourgeoises, dont la confiance reste l’atout n° 1 pour un emploi pérenne. Une combinaison taxinomique peut se structurer à partir de notre Matarena en « mater – Erena », un genre de Mère Hélène, double d’une Pénélope tissant un « tifaifai » complexe, à cause d’un Pito fuyard, à la recherche également d’un Ulysse - Persona alias Pito-anti-héros, qu’elle doit remettre debout, dans la toile sentimentale adéquate. « Mater Dolorosa », proche de notre « Notre Dame – Vierge Marie – Qui Comprend Tout » de la souffrance humaine serait le miroir des douleurs psychiques et physiques de Matarena. Son concubin et plus tard époux indécis. Pito nous intéresse par son inconsistance et insignifiance de « débutant attardé », puisque le mot tahitien de son prénom veut dire « nombril ». Son nombrilisme est égocentré en crise de sujet, car piètre ombre de lui-même, en objet futile dans son enveloppe machiste fragile et « bêta », en face de l’engeance féminine intelligemment responsable qu’est Matarena. Pito est auréolé du titre de « Roi des Cons », hétéronormé à l’extrême du « ridicule qui tue ». Il fustigera son fils Tamatoa gogo-dancer chez Georgette la DJ transgenre. Pito est bien sûr le père absent de cette famille nucléaire, où Matarena supporte ses propres douleurs psychiques et physiques sans se plaindre, mais aussi celles de ses enfants, de sa grande famille de cousins et cousines, taties et tontons, jusqu’aux personnes âgées, et même des voisins, amis et amies, et autres.
Langue hybride et mélodrames.
La langue hybride de Célestine CHV se situe au carrefour du français-langue - officielle apprise à l’école républicaine (mais ici à l’école privée catholique Anne-Marie Javouhey) et de la langue orale tahitienne (oraliture) ; une langue « kaina » autochtone affective, celle de tous les jours, pleine d’humour et de sous-entendus, qui prête à rire, à se moquer de soi-même et des autres, afin d’extirper l’angoisse sous-jacente ou le stress, symptômes et syndromes déprimants de la société capitaliste, où chaque jour est dédié au dieu Argent, et où « quand y en a plus, tant pis ! », et « quand y en a, eh ben tant mieux ! ». C’est là qu’on appelle au secours à gauche et à droite pour ne pas mourir de faim, payer la facture d’électricité, pour le frigo et ne pas rester dans l’obscurité !
Cette langue hybride rappelle le créole, comme par exemple l’expression « haa vitesse » parmi tant d’autres. Cette forme de créolisation ajoute du piment au récit et à la communication, dont le fil d’Ariane se déroule voluptueusement d’un chapitre à l’autre, au gré des morceaux de nouvelles ou de chroniques « Faaaéennes » de faits divers ou autres soubresauts, interpellant le lecteur qui ne veut pas rater une miette des histoires des multiples personnages même secondaires, et surtout féminins, qui sont mieux traités (caractère et psychologie) dans les différents diagnostics de la « doctoresse-psychanalyste en herbe » Matarena - Célestine, double ingénieux de l’autrice. C’est d’ailleurs une personnalité dynamiquement toxique au contact, dans le sens où son énergie projetée et débordante ou « mana » attrape dans sa toile d’« araignée humaine » l’écoutant ou le lecteur, qui rentre alors dans son champ magnétique, établissant une connexion joyeuse, donnant envie de communiquer, pleurer, vivre avec dans cette sphère humaine des sentiments et émotions constructives. Le kaléidoscope matarenéen ressemble à un film de la « Movida » du cinéaste espagnol Pedro Almodovar. On pourrait caser notre trilogie dans les films-comédies suivants : « Talons aiguilles », Tout sur ma mère Pepi, Bom, Lucie et les autres », et surtout « Femmes au bord de la crise de nerfs » ! Je vois bien ce dernier film être tourné dans le contexte de Faa’a, avec Lily par exemple en femme fatale militant pour l’émancipation sexuelle, etc. À écouter Almodovar, les femmes auraient davantage de choses à dire, car plus rigolotes et plus « fofolles » (entre désir et réalité), donc plus intéressantes à disséquer pour des personnages hauts en couleur, avec des tonalités pittoresques et des sonorités hystérico-comiques, au contraire des hommes à l’encéphalogramme plat, aux histoires chiantes d’autosatisfaction et d’auto-apitoiement au « ras des pâquerettes » !
L’arrière-plan littéraire : Dickens et Maupassant…
L’univers dickensien est peut-être dépassé par celui de Maupassant, puisque Célestine avoue relire régulièrement Une vie de Maupassant. Mais peut-être qu’en profondeur, Dickens l’emporterait avec son Oliver Twist (2), qui fut le premier choc littéraire de l’autrice. Cette énergie vibrante en spirale va aussi inciter Matarena à aller danser au Zizou Bar (3) avec sa cousine Lily, femme fatale. Envahie par cette spirale dynamique, Célestine va écrire l’histoire de Matarena dans tous les mouvements de son existence explosive…
Je partage le même goût dickensien que Célestine mais avec mon roman préféré David Copperfield (D.C), le sien étant Oliver Twist. Dans D.C, les symptômes et les syndromes du statut d’orphelin ont été admirablement analysés par un « grand » Dickens. Ayant été moi-même adopté, j’ai reçu mon premier cadeau-livre-à-lire à l’époque du collège, des mains de ma tante adoptive Fifi Buchin-Rere (mère de John Rere). Ce fut mon premier choc littéraire, un plaisir immense, qui allait m’orienter à jamais vers l’univers fabuleux et précieux de la littérature. Je m’étais complètement assimilé au personnage de David Copperfield, ressentant ses souffrances et toutes les émotions variées qui le traversaient corps et âme ! C’est ainsi que je suis tombé amoureux de la littérature, qui m’a sauvé de l’ignorance et de la violence du monde extérieur, me lovant ainsi dans ma bulle sentimentale intime toute pleine de savoir-être et de savoir-faire ! David luttait contre le Goliath capitaliste de l’ère de la Révolution industrielle anglo-britannique du 19e siècle victorien, aux paysages urbains hideux et pollués selon les critères esthétiques d’Oscar Wilde. Le « vilain petit canard » orphelin et vagabond se transformera en cygne-citoyen bien établi à l’extrémité du roman avec un héritage ! Ce sera la fin de son mauvais karma de résilient après ses années de galère, à l’image de Cosette et de Jean Valjean des « Misérables », ce chef d’œuvre de Victor Hugo.
À la Sorbonne (université de Paris 3), j’ai suivi un cours d’agrégation d’anglais de très haut niveau de M. André Topia, un professeur qui a entré dans l’Encyclopédie Universalis le mot-concept de « bifide » (bi-face). Il nous a expliqué avec maestria la métaphore de « copper-field » : « copper » signifiant cuivre, et « field » - champ. Le cuivre était une des richesses de l’époque, et sur les terrains d’extraction, on pouvait y voir des ouvriers et des enfants travailler comme aux travaux forcés. Dans cet axe du monde victorien (« Axis-Mundi »), l’axe vertical regroupait les riches oisifs, bourgeois entrepreneurs, qui n’arrêtaient pas de s’enrichir, et l’axe horizontal qui représentait tous les êtres exploités jusqu’à l’os, la mort ; c’est l’axe des gisants ou des futurs cadavres. La rentabilité néolibérale capitaliste broie les âmes des êtres humains qui deviennent des objets réifiés et esclaves du capital pour le capital (critique marxiste), avec un salaire en dessous du travail abattu. Un roman extraordinaire de vérité The Iron Heel (Le Talon de Fer) de Jack London dissèque également à la perfection cette dérive inhumaine du broyage des âmes. Ces quatre romans peuvent aussi nous éclairer sur les souffrances des ouvriers polynésiens et sur les petites gens du monde entier.
Une sous-culture concerne les illustrés lus par Pito, réduits à son sempiternel Akim. Enfant et ado, moi-même j’étais impatient de lire mes Akim, Miss Atomos, Zembla, Blek le Rock, Davy Crockett, Kriminal, etc… et Nous Deux, des histoires d’amour à l’eau de rose en noir et blanc. Après des menus labeurs, ma mère adoptive me donnait quelques petits sous qui m’expédiaient direct chez Ping Pong, la librairie d’occase de M. Léontieff, mon paradis labyrinthique avec tous ces petits trésors avec aussi des classiques pas chers et des vieux livres au doux parfum sucré. Un été, au début des années deux mille, je me suis rendu de Paris à Naples en bus. Arrivé dans un vieux quartier authentique, j’ai découvert avec étonnement et un grand plaisir les joujoux de mon enfance : Akim, Zembla, la revue Nous deux, etc., non loin d’immenses églises de style baroque possédant des confessionnaux érigés çà et là.
Humain trop humain : Friedrich Nietzsche à Tahiti ?
Je vais essayer de finir par cette formulation nietzschéenne célèbre, celle du grand poète-philosophe, disciple ou avatar (?) de Schoppenhauer, le cynico-stoïco-ironiste allemand. Je la mets au compte de la chaleur et tendresse tahitienne, qui transpercent l’apparente carapace des personnages des trois opus, où le nec plus ultra concerne ce trop plein d’humanité voire d’humanisme de l’âme ou du cœur psychique tahitien, qui enveloppe tous les êtres humains, et même la flore et la faune, voire Mère Nature, Pères Océan et Ciel. Ce phénomène de chaleur humaine me fait penser au dispositif amoureux de Baruch Spinoza, qui place cet axe de l’humus terrestre jusqu’aux nuées du firmament. Cette énergie d’amour protège des violences du monde extérieur, en ajoutant une deuxième peau, celle de l’habillement (« des linges sur le corps », comme « un toit sur la tête »), et aussi pour préserver la précieuse intimité humaine du foyer familial, première de toutes les forces d’amour qui consolident toute destinée humaine en marche vers une vie stable pleine d’espoir, où les femmes sont les piliers de sagesse, qui sauvent la plupart du temps les foyers des désastres existentiels, palliant le déficit éthique des hommes, à l’image déshonorante des plus jeunes qui « lâchent leur semence » n’importe comment.
Célestine parsème d’onces d’humanité le chemin de la vie, une greffe de son humilité bienveillante et généreuse. Le mot humus éclaire le personnage de Matarena, car il signifie tout ce qu’il y a de plus riche dans la terre pour la germination. L’arbre à pain y prend racine et pousse pour nourrir les affamés ; le frangipanier parfume l’air comme le tiare tahiti, et offre à l’œil ravi toutes ses couleurs diverses et magnifiques, en évacuant aussi les mauvaises odeurs. Matarena est donc heureuse dans son « hortus conclusus » (jardin secret) vierge de négativités, et elle médite dans son petit jardin d’Eden pour retrouver la paix recherchée. Après Matarena, nous avons ses trois enfants : Leilani, l’ado-Encyclopédie qui calmera sa soif de connaissances, ce qui la propulsera vers le brillant futur des études de médecine, étant passionnée de biologie et de chimie, réussissant son émancipation par un métier qu’elle adore ! Il en est de même pour Moana qui finira en cuistot étoilé, tout proche qu’il était de sa mère en cuisine ; encore une autre émancipation. Sa deuxième réussite concerne sa fiancée Vahine (amie de Leilani) aux parents bien nantis. Quant à Tamatoa, le préféré de Pito, car M. Muscle, hyper viril et engagé à l’armée, mais après un passage éclair chez les militaires, il s’est découvert une nouvelle passion pour la danse de « gogo-dancer » ou même Chippendales en boîte de nuit homo ou hétéro, peu importe ! Pito le père est déçu, mais après voir vu son fils danser à la perfection, déguisé en dieu mythologique Oro devant un parterre de femmes hystériques et toutes folles de son fils, il se ravisa pour accepter le choix d’artiste de son fils, tant qu’il reste hétéro. Même après ce spectacle homo-érotique, Tamatoa ira faire son mercato parmi des femmes mariées (les plus chaudes ?) Mama Teta est l’une des femmes les plus intéressantes car dynamique, ouverte d’esprit, et entreprenante. Elle a un métier de chauffeur de taxi après avoir passé son permis sur le tard. Elle va encore changer de voie avec la transformation de sa maison en hospice pour personnes âgées. Son fils banquier a réussi à lui obtenir l’emprunt adéquat. Elle est libre de ses choix, comme Matarena en chroniqueuse célèbre à Radio Tefana. Pour les autres personnages féminins, les grands-mères Mama Lorna (Mahi/Matarena), Mama Roti (Tehana/Pito), et la mère de Ati ouvrent cette liste. Viennent ensuite les cousines comme Lily-fatale, Giselle qui accouche n’importe où, Rita l’amie, etc. Les autres hommes sont Ati l’ami de toujours de Pito, le cousin Mori au père inconnu et hippie sympa M. accordéon, sans oublier les tontons et d’autres taties et taties marraines…
Conclusion
Célestine a donc balloté ses lectrices et lecteurs dans ses eaux tumultueuses pour rire, s’étonner, et pleurer avec, du haut de son déguisement inconscient de psy-ethno-sociologue critique. Progressivement, on navigue avec elle sur un chemin de rédemption pour la plupart des hommes irresponsables, à l’image d’un Pito méconnaissable en grand père « gâteau » de Tiare sa première petite fille, de la fille sans père, Matarena, dont le fils Tamatoa « irresponsable de sa semence » sera mis face à ses responsabilités de jeune père inconscient. Matarena va donc adopter Tiare avant de la remettre de temps à autre à son jeune père Tamatoa. Celui-ci va passer par la case « remise en question » et « réalisation sentimentale » pure et simple, mais réparatrice. Cela laisse les lecteurs perplexes, mais confiants pour la suite, et heureux de ce dénouement, comme dans un « Happy End », que désirent tout cinéphile et tout lecteur appréciateur d’une belle histoire d’amour, au nom de l’amour-amour, répété en viatique du désir critique tout au long de la trilogie.
La tragédie amoureuse « Roméo et Juliette » de l’immense dramaturge anglo-britannique William Shakespeare aurait certainement plu à Matarena, avec cette histoire d’amour tragique entre deux clans familiaux rivaux des Montaigu et des Capulet, empêcheurs du désir d’amour du damoiseau Roméo avec sa damoiselle Juliette, les amants tragiques de Vérone, avec lesquels on peut établir le parallèle Tehana – Mahi. Et comme tout est bien qui finit bien, l’amour réunit une troisième et dernière fois Pito et Matarena (rencontre, coup de foudre au snack, mariage tardif et adoption de Tiare qui les remet ensemble). Et pour couronner le tout, Pito scellera le contact de Tom Delors, le père inconnu avec sa fille retrouvée Matarena, sans oublier l’amour naissant entre la fille de Tom et Ati en recherche de stabilité sentimentale et paternelle…
1 - Récemment disparu, Rabi est ce biologiste-agriculteur-éthologue écologiste et inventeur de l’association « Colibri ». On peut aussi cogiter du côté de deux penseurs de génie du phénomène de résilience, nommément Mrs Henri Laborit et Boris Cyrulnik. Dans son livre « Éloge de la fuite », M. Laborit explique ainsi le désarroi humain, comme dans le film « Mon oncle d’Amérique ». Quant à M. Cyrulnik (psychiatre anthropologue, philosophe), son paradigme des « vilains petits canards » est révélateur de ces êtres souffrants et résilients qui deviendront des personnalités extraordinaires, comme lui d’ailleurs enfant ayant échappé aux rafles nazies… J’ai rencontré M. Laborit à Montpellier (1980), et il m’a demandé en aparté si j’étais un « petit homme vert », comme les Tahitiens qui l’ont ému par leur chaleur humaine lors de sa participation à un séminaire de psychiatrie à Vaiami (Papeete). En rencontrant M. Cyrulnik au Salon du Livre de Paris (2000), il me parla de son agréable surprise en apprenant que l’enfant adopté en Polynésie pouvait avoir plus d’une famille adoptive, en plus de sa famille biologique. C’est ainsi qu’il pouvait habiter chez l’un ou l’autre au gré de ses humeurs, et sans passer par la case administration et justice. Vive Tahiti ! Ces deux éclairages serviront pour expliciter la vie des personnages.
2 - Le mot « twist » signifie contorsion, torsion, se contorsionner, comme dans la danse du « Twist » (« Let’s twist again ») de l’époque des Sheila, Cloc Clo, et « Salut les copains ».
3 - Bar dancing de Pape’ete face au port militaire.

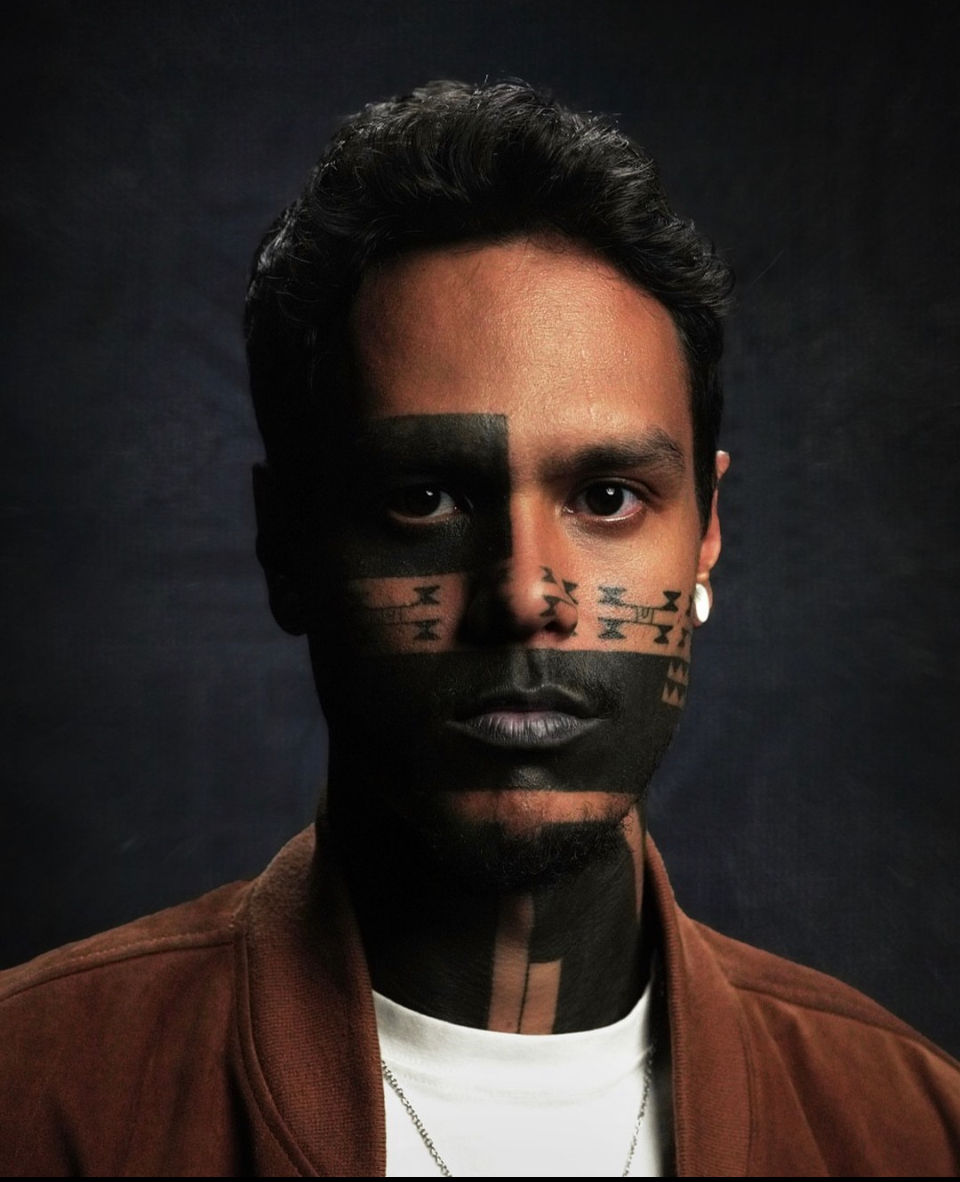

Commentaires