Mémoire des épidémies dans la littérature polynésienne
- bureau Nahei
- 1 avr. 2022
- 14 min de lecture
Dernière mise à jour : 25 juil. 2025
par Daniel MARGUERON

Sous quel prisme doit-on percevoir la Polynésie : sous celui d’un des mythes qu’elle véhicule (occidental ou autochtone) ou par le biais, tout aussi déformant de la mort subie, brutale et violente ? Ce n’est pas une question rhétorique, si l’on étudie la démographie des îles depuis 1595, date du débarquement des premiers Européens aux îles Marquises. En effet, le chercheur Emmanuel Vigneron estime à 4,5 % le poids de la mort dans les titres des ouvrages et articles consacrés à la Polynésie, en se basant sur la bibliographie de Patrick O’Reilly de 1967, ce qui est déjà important, même si cette tendance est à la baisse après 1945. Par contre, lorsque l’on ouvre les récits et qu’on les lit attentivement, la présence de la mort est très forte, - j’entends les différentes formes de mort : physique et « civilisationnelle » -, la mort fait partie des thèmes majeurs de la littérature d’abord de voyage, puis exotique enfin coloniale. Beaucoup d’écrivains évoquent la dépopulation et/ou l’introduction de maladies allogènes, comme F. R. Chateaubriand (1802), M. Radiguet (1840 et 1859), H. Melville (1842), P. Loti (1880), R. Hamon (1938), A. T’Serstevens (1951), ou encore J. Reverzy (1954).
Depuis l’arrivée des Occidentaux, la Polynésie a connu de sombres époques où ont sévi diverses épidémies. Mais il n’y a pas toujours eu des médecins et des écrivains pour en rendre compte, les décrire et observer l’attitude des Polynésiens face à ce type de mort. Les épidémies sont dans nos gènes depuis la nuit des temps - façon de parler bien sûr -, mais pour nous hommes et femmes, nés depuis le milieu du XXe siècle, qui avons été relativement épargnés ou qui avons bénéficié de vaccins et de traitements divers pour juguler bien des maladies et des affections, quelle mémoire avons-nous conservé des épidémies ?
Je distingue les maladies chroniques, importées ou non, comme la tuberculose, l’éléphantiasis, la lèpre, la syphilis, les cancers, les maladies cardio-vasculaires, et les épidémies, introduites par des navires en escale comme la dengue, la variole, la grippe espagnole, la rougeole, la fièvre typhoïde qui touchent brutalement, et de manière non durable, une population ignorant bien souvent les anti-corps pour se défendre et les gestes pour s’en protéger. Depuis quelques décennies, la population polynésienne est confrontée à des épidémies limitées, mais régulières déclenchées par des virus de type grippaux ou des arbovirus : dengue, chikungunya, zika… elles peuvent tuer sans avoir les conséquences dramatiques du passé, mais elles nécessitent les outils d’une veille sanitaire constante. Aujourd’hui, en 2020 la Covid 19 est arrivée par avion et sa simultanéité partout dans le monde a été très rapide, par contre sa létalité est encore en partie mal connue.
L’étude qui suit se base d’abord sur un ouvrage appartenant à la littérature scientifique, il s’agit d’une thèse de médecine, puis sur deux ouvrages littéraires qui traitent concrètement de la question des épidémies :

Étude sur une épidémie de dengue observée à Tahiti de janvier à mai 1885, par François-Auguste Alliot, médecin de la marine, édité en 1887.
Tuimata de Bjarne Kroepelien (Haere Pō 2009) qui décrit la grippe espagnole à Tahiti de 1919.
Fatu Hiva, le retour à la nature de Thor Heyerdahl (les Éditions du Pacifique 1976), qui évoque une épidémie consécutive à l’arrivée de la goélette La Moana en 1937.
On va donc lire ou relire ces récits et observer l’attitude des hommes face à l’épidémie et à la mort.
1- Étude sur une épidémie de dengue à Tahiti (1)
À bord de l’aviso le Volage, le médecin François-Auguste Alliot assiste à l’éclosion et au développement « d’une affection rare dans les archipels français de l’Océanie, la dengue qui a sévi de janvier à mai 1885 ». Maladie estimée à l’époque « bénigne », elle met pourtant « la population aux abois et désorganise les services publics ». L’effroi de la population fut grand, elle atteint tout le monde, sans distinction d’âge ou de sexe, mais finalement ne cause pas beaucoup de ravages dans la population. Alliot mentionne, au début de son travail de présentation de l’épidémie, son inexpérience, l’exiguïté de son bagage scientifique, et son isolement sur place, loin des « maîtres en pathologie exotique ».

Les épidémies ne naissent pas sur place, elles sont toutes importées, précise Alliot. À l’époque, le docteur Vincent qui exerce la médecine à Papeete depuis plus de vingt ans n’avait jamais observé cette épidémie, même à l’état sporadique. C’est un bâtiment de commerce, Le Havre, affrété par l’État, qui introduisit la dengue après une escale à Nouméa où elle sévissait. De Papeete elle se répandit aux districts et aux îles voisines ; la maladie est contagieuse, elle s’est déplacée jusqu’à Raiatea et Huahine, et surtout au navire militaire le Volage, objet de l’étude. L’équipage est alors confiné sur son bateau. L’hôpital manquant de lits pour accueillir les malades, c’est l’arsenal de Fare ute qui est transformé en ambulance provisoire. L’équipage de 77 hommes dont 73 atteints est réparti entre 3 pièces : celle des malades, celle des convalescents et celle des hommes valides.
La maladie a reçu plusieurs noms dans les régions tropicales : fièvre rouge, fièvre noire, fièvre articulaire. C’est aux Indes anglaises qu’elle a été nommée dengue par le médecin Mellis, sans date mentionnée dans le livre.
Les symptômes : malaise, douleurs articulaires aux membres inférieurs, température entre 38,5 et 39,9, sensations de froid, courbatures, tête lourde, nausées, peau chaude et sèche, fièvre, éruptions scarlatiniformes, troubles digestifs, vomissements, insomnie, urines sanguinolentes. La maladie dure environ onze jours :
Les traitements : limonade au citron, potion au chloral, vin de quinquina, lait, sulfate de soude, bouillon, méthode dite évacuante.
Les effets sur les malades : fatigue, amaigrissement, perte de poids de 1 à 8 kg, insomnie persistante, anorexie. La convalescence est d’une durée irrégulière. « Les empreintes de la maladie sont difficiles à effacer » indique Alliot.
Les interrogations du médecin :
Y a-t-il une période d’incubation ? Elle est estimée, sans certitude, à 4 jours.
Étude sur la desquamation : irrégulière.

Le climat a-t-il une action sur le mode propagation du germe infectieux ? Apparition en saison chaude, période la plus insalubre de l’année, du fait de la forte humidité.
Le médecin s’interroge sur l’immunité acquise et craint la récidive.
À la fin de l’épidémie, le bâtiment militaire est soumis à une totale désinfection avec de l’eau, de la potasse et de la chaux.
L’auteur note qu’il y a eu à terre quelques cas de morts chez les « indigènes ». « La létalité est moins l’œuvre de la dengue que le résultat de la pratique instinctive du bain en eau froide lorsque la fièvre atteint son maximum », écrit-il. À l’époque, on ignorait totalement la contamination par le moustique, on ne connaissait donc pas l’origine de la maladie. Jusqu’au milieu du XIXe, le Service de santé de la Marine a privilégié la santé à bord des marins, et minimisé les risques sanitaires dans le contact et la transmission de maladies avec les populations sédentaires.
2- Le récit romanesque Tuimata de Bjarne Kroepelien (2)
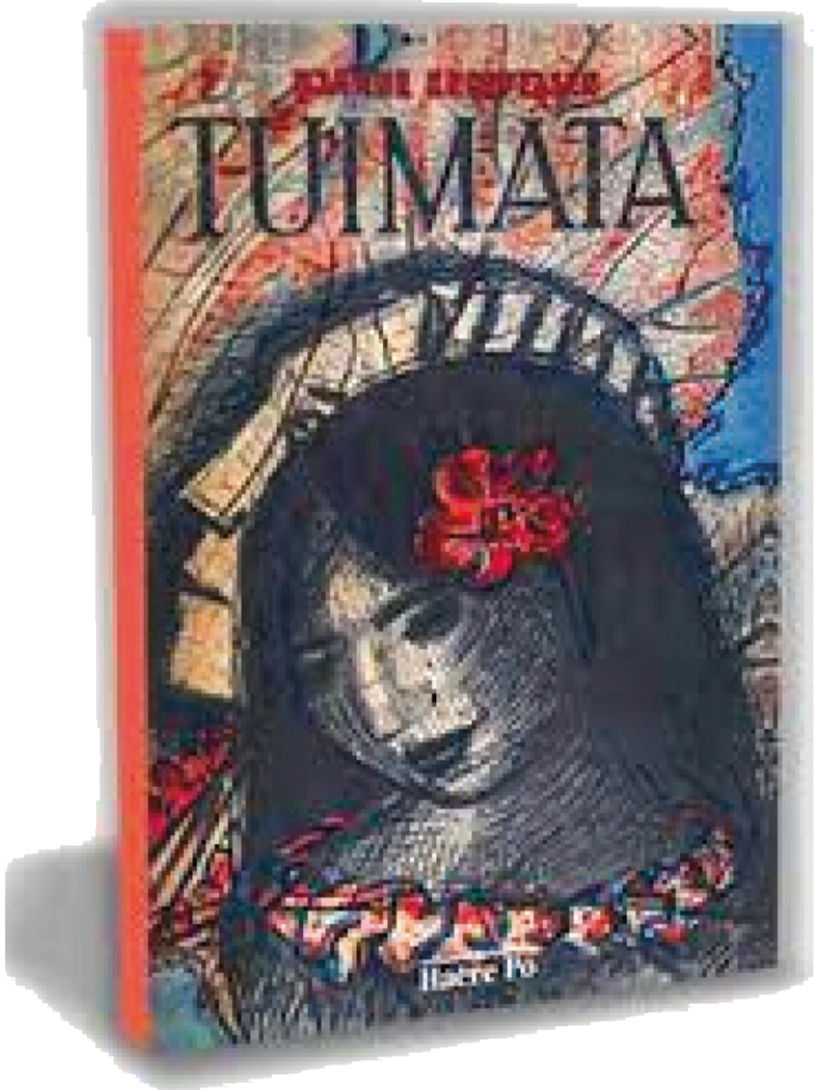
Tuimata, est le récit d’un long séjour du Norvégien Bjarne Kroepelien à Tahiti de 1917 à 1920, il a été publié en langue française par les éditions Haere Pō en 2009.
Appartenant à l’autofiction, le récit mêle expérience de vie et arrangements romanesques (et Loti n’est jamais très loin de l’écriture de Kroepelien !). Tuimata est un nom inventé qui voulait préserver l’identité véritable de la jeune fille évoquée : il s’agit en fait de la fille du chef Teriieroiterai de Papenoo. D’où les liens de tous ordres depuis un siècle entre les familles norvégienne et polynésienne.
À la toute fin du livre, débarque à Tahiti la grippe espagnole. « Un bateau est arrivé de Frisco (3). Il était rempli de malades. Les vieux sont noirs et le médecin français est mort aussi ». Ce passage est rendu également triste par la proximité du départ définitif du narrateur pour son pays la Norvège, et la fin de la relation avec Tuimata.

Sous l’effet de la fièvre, les Tahitiens se baignent à la rivière, le narrateur visite une maison où gît sur un pareu une femme décédée « pendant qu’un enfant jouait sur le sol avec une noix de coco ». Tout le monde a conscience de la mort à venir. Lovaina Chapman de l’hôtel Tiare vient de décéder aussi, le pharmacien est malade et va mourir peu de jours après. « Que fait-on pour les malades s’inquiète le narrateur ? Les bureaux de l’administrations sont fermés ». Un certain Mac Quarrie organise l’hôpital, les gens meurent surtout chez eux où ils se sont confinés. Parfois du sang coule sur le sol, recouvert rapidement de mouches. Le narrateur verse le pétrole des lampes et met le feu aux maisons contaminées. Parfois les morts sont enterrés dans le voisinage des fare, à même la terre, dans un trou simplement creusé. Il emmène au cimetière deux morts trouvés « sur la véranda des Bambridge ». Il cherche et obtient de la nourriture pour les malades confinés chez eux ou hospitalisés. Toutes les communautés sont touchées, Tahitiens, Chinois, Popa’a. Il observe qu’il est difficile d’obtenir de l’aide des gens valides qui ont peur et adoptent une conduite de fuite. « Deux semaines s’écoulèrent et un tiers de la population de Tahiti mourut », écrit-il.
Et puis Tuimata tombe, elle aussi, malade. « Teriieroo, dit-elle, je vais mourir ; promets-moi que tu vas m’enterrer à Taunoa et que tu mettras une croix sur ma tombe ». Elle ne veut pas être jetée à la mer ou dans un trou, inhumée n’importe où, sans rite ni sépulture. « Oui je te le promets », affirme son ami. Et Tuimata meurt. « Calmement, elle s’était couchée, avait fermé les yeux, et Taaroa l’emmena dans le ciel bleu où il rassemble tous les Tahitiens ». Peu après le narrateur embarque pour son pays de naissance et, au moment où le bateau sort de la rade de Papeete, il pense à ce qu’il laisse sur la terre tahitienne et à son amie décédée : « sous les fleurs de tiare blanches et dans l’alizé, mon cœur est enterré ».
Les rapports officiels estiment entre 10 et 15 % la population qui est décédée de la grippe espagnole, alors que 90 % en a été atteinte. Au début bénigne, l’épidémie se développe très rapidement dans une deuxième phase. Les effets sur la natalité vont être importants pendant quelques années.
3- Fatu Hiva de Thor Heyerdahl

Le deuxième norvégien, Thor Heyerdahl se rend en Polynésie en 1937. Son livre Fatu Hiva, le retour à la nature est publié en français en 1976 aux Éditions du Pacifique. Cet ouvrage est une expérience de vie aux Marquises et surtout une méditation passionnante sur la capacité ou plutôt sur l’inadaptation pour un occidental de revenir à un mode de vie traditionnel voire ancestral. Ce qui nous intéresse nous dans ce livre c’est l’arrivée d’une épidémie à Fatu Hiva.
Thor et sa femme Liv résident en dehors du village. Un jour un cavalier leur apporte de la viande, « il semblait blafard et fatigué ». Ce dernier leur demande si la peste était parvenue jusqu’à eux. On apprend ainsi que la goélette La Moana a fait escale à Hanavavae et depuis toute l’île est atteinte. « Notre impression de paradis terrestre s’était évanouie », écrit Heyerdahl. Notre couple de Norvégiens l’attrape et au point culminant « je n’eus qu’un mal de gorge » écrit Thor, qu’il traite de « légère grippe ». Tout autre est la situation des Marquisiens. Le sacristain Tioti leur rend visite, « il était blême, avait une mauvaise toux, ses yeux brillaient de fièvre », il leur demande de descendre au village photographier son dernier fils et leur indique que tous ses autres enfants sont morts. Dans la plupart des cases, il y avait « des réceptions funéraires, on saignait les cochons de lait. Les gens marchaient repliés sur eux-mêmes, dans les maisons pas une fenêtre n’était ouverte ». Chacun s’est habillé de vêtements qui couvraient tout le corps. Pas de médecin ou d’infirmier sur l’île. « Jeunes et vieux gisaient par terre, serrés les uns contre les autres et les moribonds toussaient à la face de leurs voisins ». Le petit de Tioti meurt finalement et Thor fait, à la demande des parents une photo de l’enfant décédé. La communication avec les Marquisiens est difficile pour les Heyerdahl : comment expliquer ce qu’est un virus, comment recommander des préceptes d’hygiène ? « Les insulaires accablés, souffraient moins de leur manque de résistance que de leur ignorance des moyens susceptibles d’éviter la contagion et de lutter contre le mal », écrit encore Thor Heyerdahl. Le menuisier Ioane apporte et dépose les cercueils dans la cour des maisons avant que les malades ne meurent !

Le couple Heyerdahl mène une réflexion sur la médecine, en général considérée comme un bienfait de la civilisation, il fait le procès des étrangers, vecteurs des maladies importées, et s’interroge néanmoins sur les causes des nombreuses maladies qui affectent l’homme en général. Est-ce parce que « nous vivons une vie malsaine et non naturelle ? », se demande Liv, qui ne perd jamais de vue son souci écologique avant la lettre.

Comportements face à la mort
À l’issue de la lecture de ces trois documents, demandons-nous ce qui domine comme conduite, attitudes et pensées, face à la mort :
Essentiellement la résignation, le défaitisme, la population se sent vaincue par un mal plus fort qu’elle contre lequel elle ne peut rien. Elle attend tout d’en haut, des responsables, la nourriture et les soins. La mort est intégrée au temps de la vie, à l’espace des vivants, les morts veillent sur les vivants. Cette mort-là subite, violente, rapide comme une guerre éclair est subie.
Une certaine résilience se manifeste parfois, des initiatives sont observées, comme quitter l’île lorsque sévit une épidémie pour échapper à la mort (et ainsi la propager ailleurs), par contre les initiatives d’aide et de solidarités sont entravées par l’absence de consignes et de politique claire venant de l’Administration coloniale, débordée et visiblement incompétente.
Le recours au divin ; trouver un coupable. Peut-on lutter contre la colère divine ? La mort est un châtiment divin, mais provenant de quels dieux ?
Quel est le dieu qui inflige les épidémies et pourquoi ?
Le missionnaire de la LMS, William Ellis, observe des cas d’épidémie aux îles Australes en 1803, au début de l’évangélisation, et écrit que les survivants supposaient que ces maux venaient des missionnaires et de leur Dieu, « ils les considéraient comme les assassins de leurs compatriotes et lorsque Oro aura repris de son autorité, ils sentiraient les effets de sa vengeance ». Maximo Rodriguez développe la même argumentation qui lui vient de Vehiatua, malade parce que son dieu « lui a lancé une maladie dans sa tête », suite à la rencontre du tahua et d’un père catholique.
Quelques décennies plus tard, changement de braquet. En 1863 l’aviso Le Diamant fait escale à Taiohae ; il rapatriait de malheureux Polynésiens « razziés » par des recruteurs péruviens ; une épidémie sévit à bord - 21 morts sont dénombrés -, le commandant, affolé, dépose à terre consciemment des malades, dont il ne sait que faire « je vous apporte la petite vérole » dit-il au Résident, responsable de l’administration française. Le père Pierre Chaulet décrit alors l’épidémie à Nuku-Hiva : plus de 1000 morts soit 50 % de la population, l’épidémie est exportée à Ua Pou qui enregistre 600 morts. Les corps sont abandonnés sur les paepae et dans les trous à popoi. Les chiens et les cochons dévorent les mourants. « Certains hommes s’enterrent vivants pour échapper à la dent de ces animaux voraces ». Le père Chaulet pense que les Marquisiens sont morts de leur « iniquité ». Ce « fléau, écrit-il, a été apportée par la Divine Providence pour arrêter les crimes des Polynésiens : ivrognes, voluptueux, orgueilleux, insolents, ingrats, désobéissants, calomniateurs, traîtres, querelleurs, remplis de méchancetés, de fornications et d’adultères, de rapines ». Rien que ça ! Les rites funéraires sont abandonnés. Mais des faits positifs sont observés par le missionnaire : d’abord la tribu des Taïpis se convertit au christianisme et, mentionne encore Chaulet soulagé, « ils moururent tous munis des sacrements de l’Église ». Hors de l’Église, point de salut, a-t-on longtemps affirmé !
Puis le navire fit route vers Tahiti où le Diamant fut soumis à une stricte quarantaine qui permit à l’île principale d’échapper à la contagion et à l’épidémie.
Conclusion
Les virus circulent, demeurent, s’éloignent un temps, mais ils sont toujours là, peut-être même ont il tendance à se développer compte tenu de la croissance de la population mondiale, de la mobilité des hommes et de l’oubli des gestes barrières. L’insularité et la petitesse des îles peuvent, selon les cas, constituer une barrière naturelle ou un handicap, elles « accentuent la fragilité des populations », estime encore Emmanuel Vigneron. Sur une île, la menace vient le plus souvent par la mer (les guerres tribales d’autrefois entre les vallées mises à part). La première quarantaine a sans doute été instituée en Europe vers 1350 avec l’apparition d’une peste noire. À Tahiti c’est l’îlot de Motu Uta qui a servi à cette fonction d’attente. Rappelons qu’avant l’arrivée des Européens, les populations du Pacifique étaient certainement épargnées par les épidémies du fait de l’absence de paludisme, de leur isolement et de la durée des navigations lorsqu’elles avaient lieu.
Les épidémies rendaient, rendent encore la mort omniprésente : une théologie culpabilisatrice de comptoir en fit autant de punitions divines. Ailleurs et en d’autres temps, on accusa les Juifs d’en être les vecteurs. Les épidémies ont modifié les représentations de la mort, elles nous rappellent notre condition humaine commune, à savoir qu’elles touchent tous les hommes, quels que soient leur âge, leur classe sociale, leur ethnie, leur sexe, bref selon un principe de grande égalité. Cela dit, pour avoir des chances d’être bien ou mieux pris en charge et bénéficier de thérapies récentes, il vaut mieux résider dans un pays riche que pauvre…
Bibliographie
ALLIOT Auguste, Étude sur une épidémie de dengue observée à Tahiti de janvier à mai 1885, 1887.
BUCHET Christian (sous la direction), L’homme, la santé et la mer, Honoré Champion, Paris 1997.
ELLIS William, À la recherche de la Polynésie d’autrefois, traduction Marie Sergueiew et Colette de Buyer-Mimeure, Société des Océanistes, Paris 1972.
HEYERDAHL Thor, Fatu Hiva, le retour à la nature, traduction de Aliette Henri Martin, Les Éditions du Pacifique, 1976.
KROEPELIEN Bjarne, Tuimata, traduction Joëlle Petersen, Haere Pō, 2009.
VIGNERON Emmanuel, Recherches sur l’histoire des attitudes devant la mort en Polynésie française, thèse, Toulouse 1985, devenue Le Territoire et la santé, CNRS éditions, Paris 1999.
1 - Petit ouvrage de 35 pages, découvert par la ta’ote bibliophile bien connue à Tahiti, Christine Duchateau que je remercie pour le prêt de cet ouvrage plus que rare.
2 - La littérature mondiale a traité fréquemment la question des épidémies. L’écrivain américain Jack London (1876-1916), l’auteur bien connu de Croc-Blanc de l’Appel de la forêt ou de son autobiographie romancée Martin Eden, effectue un long séjour dans le Pacifique à la fin de la première décennie du XXe siècle. Il extrait de son aventure le récit À bord du Snarck (1911). Mais pour nous, dans le cadre de notre étude, il publie surtout en 1912 le récit de science-fiction La peste écarlate (The Scarlet Plague). L’histoire, sensée se dérouler en 2073 à San Francisco, raconte qu’une épidémie mortifère s’est propagée sur terre en 2013, provoquant une éruption cutanée rouge. Quelques être humains ont pu échapper au désastre et ont reconstitué une petite société humaine, retournée à l’état de nature, et malheureusement oublieuse des bienfaits du passé et des acquis de la civilisation. Un grand-père âgé, rescapé de l’épidémie, évoque devant ses petits enfants, analphabètes et illettrés, ce qu’était le monde ancien. La société à venir pourra-t-elle se ré-humaniser ?
3 - Voir le JO du 15 novembre 1918, puis le rapport du directeur de la santé des EFO, le docteur Allard de février 1919. Le Bulletin de la SEO n° 338 (mai-août 2016), consacré à la Grande Guerre, reproduit le rapport du docteur Allard. Ce dernier indique la présence forte de la grippe, mais sous une forme bénigne, dans les quelques mois qui ont précédé l’épidémie proprement dite, introduite par deux navires le vapeur Navua et le Paloma. Allard signale la présence à Tahiti de « semeurs de panique, oiseaux de mauvaise augure, annonciateurs de fin du monde qui, à Tahiti comme ailleurs surgissent dans les périodes troublées ». Il précise que les poilus tahitiens de l’Armée d’Orient, revenus récemment, n’ont pas été contaminés par l’épidémie. Pour expliquer les raisons de cette immunité, il émet plusieurs hypothèses : la quinisation dont ces soldats ont été l’objet ou la vaccination qu’ils ont subies comme soldats. Il indique que les représentants des églises ont distribué des potions antigrippales aux fidèles, et que les soignants (très peu nombreux) se sont fortement mobilisés pour aider les malades. Il estime, à la date où est rédigé son rapport (1er février 1919), que les archipels éloignés ont été exempts de l’épidémie. Il chiffre ainsi les décès : Tahiti avec 1250 mots pour 7000 habitants, Moorea 253 décès pour 1500 résidents, Makatea 95 morts pour une population de 800 âmes, enfin les Iles Sous-le-Vent avec 900 décès pour 6000 habitants.
Il est en outre fort intéressant de comparer les deux textes traitant du même sujet : le docteur Allard a tendance à minimiser les effets de la grippe espagnole en instaurant une distance « administrative », tandis que Kropelien dramatise à souhait la situation, ce qui est la logique d’un récit littéraire, dont l’intérêt est proportionnel aux affects déclanchés par l’écriture.



Commentaires