Notre Océan d’Îles
- bureau Nahei
- 1 avr. 2022
- 24 min de lecture
Dernière mise à jour : 4 août
EPELI HAU’OFA
Our Sea of Islands
Traduction Henri THEUREAU

The Contemporary Pacific, Volume 6, Number 1, Spring 1994, 147–161. First published in A New Oceania : Rediscovering Our Sea of Islands, edited by Vijay Naidu, Eric Waddell, and Epeli Hau‘ofa. Suva : School of Social and Economic Development, The University of the South Pacific, 1993.
Le présent essai soulève certains problèmes de grande importance pour notre région, et offre une vision de l’Océanie qui est nouvelle et optimiste. Ce que je dis ici risque de troubler un certain nombre d’hommes et de femmes qui ont consacré leurs vies à l’Océanie et pour qui j’ai – et j’aurai toujours – le plus grand respect et la plus profonde affection.
Dans notre région, deux niveaux de fonctionnement peuvent servir de cadre au propos de cet article. Le premier est celui des gouvernements nationaux et de la diplomatie régionale et internationale, où se planifient et se décident le présent et l’avenir des états et territoires insulaires du Pacifique. Les discussions y sont l’apanage des politiciens, des bureaucrates, des officiels des corps constitués, des diplomates et des militaires, et des représentants des groupes commerciaux et financiers, souvent en conjonction avec des donateurs et des organisations internationales de prêt, et avec le conseil éclairé de consultants et d’experts universitaires. Une grande part de ce qui passe par ce niveau-là concerne l’aide, les transferts de fonds, le commerce, les investissements, la défense et la sécurité, toutes choses qui plongent de plus en plus le Pacifique dans l’assujettissement aux nations puissantes.
L’autre niveau est celui des gens ordinaires, paysans et prolétaires qui, à cause de l’insuffisance du « ruissellement » du haut de la pyramide, de leur scepticisme concernant les politiques déclarées et tout ce genre de choses, ont tendance à planifier et à décider de façon indépendante ce qui concerne leurs vies, parfois avec des résultats spectaculaires et surprenants qui restent largement ignorés des hautes sphères. De plus, les experts universitaires et les consultants ont tendance à négliger ou à comprendre de travers les activités des gens au bas de l’échelle, parce qu’elles ne cadrent pas avec les conceptions dominantes sur la nature de la société et ce que devrait être son développement.
Les visions du Pacifique au niveau macroéconomique et macropolitique diffèrent souvent de façon notoire de celles que peuvent avoir, à leur niveau, les gens ordinaires. La vision de l’Océanie présentée dans cet essai est basée sur mes observations de comportements « à la base », au niveau des gens ordinaires.
Après avoir précisé mon angle de vue, je propose maintenant une affirmation évidente, à savoir que les opinions des gens en position dominante à propos de leurs subordonnés pourraient bien avoir des conséquences significatives sur l’image que ceux-ci ont d’eux-mêmes, et sur leur façon de gérer la situation où ils se trouvent. Ces opinions, qui visent souvent à dénigrer et déprécier, sont une part intégrante de la plupart des relations de domination et de subordination, où les dominants ont des comportements ou disent des choses qui sont acceptées par les dominés, lesquels, à leur tour, ont des comportements qui servent à perpétuer ces relations.
En Océanie, les points de vue qui dénigrent et déprécient les cultures indigènes sont repérables dès les premières années de contact et d’interaction avec les Européens. La condamnation générale, par les missionnaires chrétiens, des cultures océaniennes – considérées comme sauvages, lascives et barbares – a eu un effet durable et négatif sur le point de vue qu’ont les peuples d’Océanie de leur propre histoire et de leur propres traditions. Dans nombre de sociétés du Pacifique, les gens divisent encore leur histoire en deux parties : l’ère des ténèbres associées à l’état sauvage et à la barbarie ; et l’ère de la lumière et de la civilisation introduites par le christianisme.
En Papouasie–Nouvelle-Guinée, les mâles européens se faisaient appeler « master » – maître – et appelaient « boys » leurs travailleurs indigènes (1). Même les agents de police indigènes étaient appelés « police boys ». Cette utilisation de la langue contribuait à renforcer la stratification sociale établie par le système colonial selon des divisions ethniques. Un résultat direct de ces pratiques coloniales dépréciant les peuples et les cultures de Mélanésie – considérées comme encore plus primitives et barbares que celles de Polynésie – est visible dans les tentatives faites dans les années suivant les indépendances par certains éloquents Mélanésiens pour revaloriser leur identité culturelle en la décrassant de tous les stigmates du dénigrement colonial. Des leaders politiques comme Walter Lini du Vanuatu et Bernard Narokobi de Papouasie–Nouvelle-Guinée ont dépensé une grande partie de leur énergie à célébrer les vertus des valeurs mélanésiennes, égales sinon supérieures à celles de leurs anciens colonisateurs.
Les Européens n’ont pas inventé la dépréciation. Dans de nombreuses sociétés elle était partie intégrante des cultures indigènes. Dans les sociétés aristocratiques de Polynésie, des relations parallèles de domination et de subordination, avec tout leur arsenal d’attitudes et de comportements appropriés étaient à l’ordre du jour. À Tonga, le terme signifiant « gens du commun » est me’a vale, soit « les ignorants », survivance de l’époque où l’aristocratie contrôlait tous les savoirs importants de la société. Maintenir les gens ordinaires dans l’obscurité et les traiter d’ignorants rendait plus facile la tâche de les soumettre et de les contrôler.
J’aimerais, cependant, concentrer mon propos sur une notion qui prévaut en ce moment à propos des insulaires et de leur environnement matériel, notion qui, si elle n’est pas contrée par des points de vue plus constructifs, pourrait provoquer des dégâts durables à l’image que ces insulaires ont d’eux-mêmes, et à leur capacité d’agir avec une relative autonomie dans les efforts qu’ils font pour survivre décemment au sein du système international où ils se sont retrouvés. Il s’agit d’un point de vue dépréciateur qui a été propagé involontairement, surtout par des spécialistes des sciences sociales qui ont par ailleurs un souci réel du bien-être des peuples du Pacifique.
Selon ce point de vue, les petits états et territoires insulaires du Pacifique, c’est-à-dire la totalité de la Polynésie et de la Micronésie, sont de taille beaucoup trop insignifiante, possèdent trop peu de ressources naturelles, et sont trop isolés des centres de croissance économique pour que leurs habitants arrivent un jour à s’élever au-dessus de leur présente condition de dépendance envers la générosité des pays riches.
Initialement, j’étais en plein accord avec cette perspective, et j’ai participé activement à sa diffusion. Elle semblait en effet basée sur des preuves irréfutables, sur la réalité de nos existences. Les événements des années 1970 et 1980 vinrent confirmer sa validité. L’ère d’autonomie qu’on espérait voir suivre l’indépendance politique ne se matérialisa pas. Nos leaders nationaux étaient à l’avant-garde d’une ruée décidée à s’assurer des aides financières tous azimuts ; nos économies stagnaient ou déclinaient ; nos environnements se détérioraient ou se trouvaient menacés, et nous n’y pouvions pas grand-chose ; nos propres populations s’exilaient vers des pâturages plus verdoyants. Le peu qui restait de nos ressources, y compris nos zones économiques exclusives, était vendu à l’encan, au plus offrant. Certaines de nos îles étaient devenues, selon le terme d’un spécialiste en sciences sociales, des « sociétés MIRAB » – de pitoyables micro-états à jamais condamnés à dépendre de la Migration, des Remises (transferts de fonds), de l’Aide, de la Bureaucratie (2), et non d’aucune réelle productivité économique. Même les nations mélanésiennes, mieux pourvues en ressources naturelles, s’enlisaient dans la dépendance, l’endettement et, apparemment, des divisions sociales sans fin et une instabilité politique chronique. Quel espoir y avait-il pour nous ?
Ce point de vue peu réjouissant sur notre existence était mis en avant avec un tel acharnement que je finis par m’interroger sur ses implications. Je tentais de trouver des portes de sortie, mais en vain. Et puis, il y a deux ans j’ai commencé à remarquer les réactions de mes étudiants lorsque je décrivais et expliquais notre situation de dépendance. Leurs visages se défaisaient à vue d’œil, ils demandaient des solutions, je n’en avais aucune à leur offrir. Cette notion de petitesse me paralysait au point de penser que, même si nous arrivions à améliorer nos méthodes de production, par exemple, la taille objective de nos îles finirait par imposer des limites si sévères que nous finirions quand même par échouer.
Mais les visages de mes étudiants continuaient à me hanter sans relâche. Je commençais à me poser des questions. Quelle sorte d’enseignement pouvait consister à me présenter devant des jeunes gens de chez moi, des gens que j’appelle les miens, qui sont venus à l’université avec de grandes espérances pour l’avenir, et à leur dire que nos pays sont désespérément nuls ? N’est-ce pas là le comble du néo-colonialisme ? Faire croire aux gens qu’ils n’ont d’autre choix que la dépendance ?
Je compris bientôt ce que j’étais en train de faire : en propageant cette forme de désespoir impuissant, je participais activement à notre propre dépréciation. Je décidai d’affronter ce problème, mais je me dis que, puisque toute nouvelle perspective serait soumise à certains des esprits les plus brillants et les plus respectés de la région, il fallait qu’elle soit basée sur des recherches et des études solides si je voulais qu’elle soit prise au sérieux. C’était là une tâche impressionnante, et j’hésitais, intimidé.
C’est alors que me parvint une invitation à venir faire des conférences à Kona et à Hilo, sur Big Island à Hawaï, fin mars 1993. Celle de Kona, à une réunion de l’Association pour l’Anthropologie Sociale en Océanie, avait été écrite avant que je quitte Fidji. Ce que je dirais à Hilo, à l’Université de Hawaï, prenait forme dans mon esprit et je pensais l’écrire une fois arrivé là-bas. J’avais décidé de mettre ma nouvelle perspective à l’épreuve, bien que je n’y aie pas encore consacré de recherches suffisantes. Mais je ne pouvais plus attendre : il fallait que j’en parle. La route de Kona à Hilo fut mon « chemin de Damas ». J’y découvris des scènes grandioses, telles que je n’en avais jamais vues : l’étrange teinte noire des régions couvertes par la lave d’éruptions volcaniques récentes ; la lointaine majesté de Maunaloa, les longues pentes douces du plus grand volcan du monde ; les impressionnants cratères de Kīlauea menaçant d’exploser sans prévenir ; et le fleuve de lave non loin sur la côte. Sous l’égide de la déesse Pele, et sous mes yeux, Big Island la grande île grandissait encore, s’élevant du tréfonds de l’océan puissant. Le monde de l’Océanie n’est pas petit : il est énorme et ne cesse de grandir quotidiennement.
L’idée que les pays de Polynésie et de Micronésie sont trop petits, trop pauvres, et trop isolés pour se développer et atteindre aucun degré significatif d’autonomie, est le point de vue d’un économisme et d’un déterminisme géographiques d’une espèce fort étroite, qui néglige l’histoire culturelle et le processus contemporain de ce qu’on peut appeler l’élargissement du monde que sont en train de réaliser des dizaines de milliers d’insulaires ordinaires du Pacifique d’un bout à l’autre de l’océan – de l’est à l’ouest et du nord au sud, sous le nez des experts et des consultants universitaires, des agences régionales et internationales de développement, des bureaucrates planificateurs et de leurs conseillers, et des fonctionnaires des douanes et de l’immigration – rendant aberrantes toutes les frontières nationales et économiques, lesquelles n’ont été définies que très récemment et quadrillent un océan qui était sans frontières depuis des millénaires avant l’apothéose du Capitaine Cook.
Si cette étroite perspective déterministe n’est pas remise en question et contrée, elle pourrait contribuer de façon importante à un éventuel confinement de petits groupes humains dans un état perpétuel de tutelle, où les terres et les eaux qui les environnent seraient à la merci des manipulateurs de l’économie globale et d’un « ordre mondial » d’une espèce ou d’une autre. La dépréciation, quelle qu’en soit l’accoutrement, si elle est intériorisée assez longtemps et transmise de génération en génération, peut mener à la paralysie morale, à l’apathie, et au genre de fatalisme qu’on peut voir chez ceux de nos semblables qui ont été parqués et confinés dans des réserves ou des camps d’internement. Les gens, dans certaines de nos îles sont en danger de se retrouver confinés dans des « réserves mentales », s’ils ne le sont déjà dans des réserves physiques. Je pense ici aux populations des Îles Marshall, qui ont été déplacées, victimes des essais nucléaires et des tirs de missiles américains.
Est-ce que, dans la plus grande partie de l’Océanie, les gens vivent confinés dans de minuscules espaces ? La réponse est oui, si l’on croit ce que disent certains tenants des sciences sociales. Mais l’idée de petitesse est relative : elle dépend de ce que l’on inclut et de ce que l’on exclut en calculant la taille. Ceux qui arrivent de continents, ou d’îles adjacentes à des continents – la plus grande majorité des êtres humains vivent dans des régions de ce type – lorsqu’ils voient une île polynésienne ou micronésienne, ils la trouvent naturellement petite, voire minuscule. Leur estimation est uniquement basée sur la dimension de la surface de terre qu’ils voient.
Mais si nous considérons les mythes, légendes, traditions orales et cosmologies des peuples d’Océanie, il devient évident qu’ils ne concevaient pas leur monde selon des proportions microscopiques. Leur univers ne comportait pas seulement des surfaces terrestres, mais aussi l’océan qui les entourait, aussi loin qu’ils savaient s’y aventurer et l’exploiter, avec un inframonde dont les habitants contrôlaient le feu et faisaient trembler la terre, et des cieux peuplés d’une hiérarchie de dieux puissants, d’étoiles et de constellations qui possédaient des noms et sur qui l’on pouvait compter pour trouver sa route à travers les mers. Leur monde était tout sauf minuscule. Ils pensaient en grand et racontaient leurs hauts-faits de façon épique. Un des athlètes océaniens légendaires était si puissant qu’au cours d’un affrontement il fit preuve d’une force telle que son javelot perça l’horizon et, cette nuit-là, réapparut en déchirant le ciel comme un météore. Il réapparaît même de temps en temps pour rappeler aux gens cet exploit. Et, en ce qui me concerne, il est encore là-haut, quelque part du côté de Jupiter peut-être. Ce fut la première fusée qu’on ait jamais envoyée dans l’espace. Aujourd’hui encore, les insulaires adorent exagérer les faits au-delà de toute proportion. La petitesse est un état d’esprit.
Il y a un monde de différence entre imaginer le Pacifique comme « des îles dans une mer lointaine » et le voir comme « un océan d’îles ». La première expression met l’accent sur les surfaces de terre ferme dans l’immensité océane loin des centres de pouvoir. Ce point de vue met l’emphase sur la petitesse et l’éloignement des îles. La seconde est une perspective plus holiste, qui donne à voir les choses dans la totalité de leurs relations. Je reviendrai sur ce point plus tard. Les continentaux, les Européens pour être précis, en entrant dans le Pacifique après avoir traversé d’immenses étendues d’océan, accréditèrent la vision de ces « îles dans une mer lointaine ». Cette perspective fait de nos îles des points minuscules, isolés dans l’immensité de l’océan. Plus tard les continentaux – Européens et Américains – tracèrent des lignes imaginaires sur cette immensité, les frontières coloniales qui, pour la première fois, confinaient les peuples de l’océan sur leurs minuscules espaces. Ces frontières aujourd’hui définissent les états et territoires insulaires du Pacifique. Je viens d’utiliser le terme peuples de l’océan parce que nos ancêtres, qui vivaient dans le Pacifique depuis plus de deux mille ans, voyaient leur monde comme « un océan d’îles » plutôt que comme des « îles dans la mer ». On trouve un exemple de cela dans une façon fréquente de désigner les gens, comme à Tonga où les habitants de l’île principale, l’île capitale, parlaient autrefois de leurs compatriotes du reste de l’archipel moins comme « ceux des îles extérieures » comme le diraient les tenants des sciences sociales, que comme kakai mei tahi – ou simplement tahi – « ceux de la mer ». Cette dénomination révèle le postulat sous-jacent que la mer est le lieu auquel ces gens-là appartiennent.
La différence entre ces deux perspectives se reflète aussi dans les deux termes utilisés en anglais pour nommer notre région : Pacific Islands et Oceania. Le premier terme, Pacific Islands, est celui qui prévaut un peu partout ; il décrit de petites surfaces terrestres perchées sur des récifs ou des montagnes submergées. Presque aucun anglophone – qu’il soit économiste, consultant expert, planificateur gouvernemental ou employé d’une banque de développement dans la région – n’utilise le terme Oceania, peut-être parce qu’il semble un peu romantique et grandiloquent, et pourrait se référer à quelque chose de si vaste que cela les obligerait à une révision radicale de leurs perspectives et de leurs politiques. Les Français et autres Européens utilisent le terme Oceania ou Océanie bien plus souvent qu’aucun anglophone, à l’exception de quelques anthropologues fort dénigrés et autres universitaires anglo-saxons toqués des grands espaces marins. Ce n’est peut-être pas une coïncidence que l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, tous anglophones, aient des intérêts beaucoup plus importants dans le Pacifique, et la façon dont il est perçu, que ne peuvent en avoir les lointaines nations européennes.
L’Océanie renvoie à un océan d’îles et à leurs habitants. Le monde de nos ancêtres était une mer immense pleine de lieux à explorer, à investir pour en faire leur home, et les peupler de générations de marins et de voyageurs à leur image. Les gens élevés dans cet environnement étaient chez eux sur l’océan. Ils y jouaient dès qu’ils savaient tenir debout, ils y travaillaient, ils s’y faisaient la guerre. Ils avaient mis au point des techniques élaborées pour naviguer dans les eaux qui leur étaient familières, et acquis le courage de traverser même les longues distances qui séparaient les archipels.
Leur monde était immense. Les gens et les cultures s’y mouvaient et s’y mêlaient, sans être gênés par des frontières de l’espèce que les pouvoirs impériaux érigeraient beaucoup plus tard. D’une île à l’autre ils allaient à la voile pour commercer et se marier, agrandissant ainsi des réseaux sociaux qui permettraient une plus grande circulation des biens. Ils voyageaient et rendaient visite à des membres de leur famille dans une grande variété d’environnements naturels et culturels, pour étancher leur soif d’aventure et même pour se battre et dominer.
Fidji, Samoa, Tonga, Niue, Rotuma, Tokelau, Tuvalu, Futuna et Uvea (3) formaient une grande communauté d’échange où les biens et les gens, leurs techniques et leurs arts, circulaient continuellement. À partir de cette communauté, les gens se sont aventurés au nord et à l’ouest, dans les archipels des Kiribati, des Salomons, du Vanuatu et de Nouvelle-Calédonie, qui formaient un arc où les échanges étaient moins intensifs. Les preuves de ces voyages se trouvent dans de petites colonies, à l’intérieur de la Mélanésie, de descendants de ces peuples de marins. [Il faudrait être marin d’eau douce et aveugle pour dire que des colonies de ce type, ainsi que celles de Nouvelle-Zélande et d’Hawaï, ont été créées à la suite de voyages accidentels par des équipages « égarés » – sans doute partis à la pêche avec femmes, enfants, cochons, chiens, semis et plants d’arbres fruitiers – au cours d’un cyclone.] Les Îles Cook et la Polynésie Française formaient une communauté identique à celle de leurs cousins plus à l’ouest ; des individus intrépides appartenant à cette communauté s’aventurèrent au sud et fondèrent des colonies sur Aotearoa (la Nouvelle-Zélande), tandis que d’autres partaient dans la direction opposée pour découvrir l’archipel d’Hawaï et s’y installer. Au nord de l’équateur, on trouve aussi la communauté dont le centre était Yap.
On pense que la Mélanésie est le monde le plus fragmenté qui puisse exister : ensemble de minuscules communautés isolées, par îles ou par vallées et par au moins un millier de langues différentes. La vérité est que de vastes régions de Mélanésie étaient intégrées grâce à des systèmes d’échanges commerciaux et culturels qui étaient encore plus complexes que ceux de Polynésie ou de Micronésie. Les langues véhiculaires et le fait que la plupart des Mélanésiens sont multilingues (on ne peut guère en dire autant de la plupart des pays continentaux bordant le Pacifique), rendent totalement aberrante l’idée qu’ils étaient et seraient encore dans une confusion babélienne. C’était dans l’intérêt de l’impérialisme, et c’est dans l’intérêt du néo-colonialisme que de promouvoir cette flagrante absurdité à propos de la Mélanésie.
Les preuves de conglomérats insulaires, économiques et culturels, sont évidentes dans les traditions orales des îles, et dans les liens de sang qui existent encore aujourd’hui. Les plus grands chefs de Fidji, de Samoa et de Tonga, par exemple, maintiennent encore des connexions familiales qui ont été établies des siècles avant l’entrée des Européens dans le Pacifique, à l’époque où il n’y avait pas sur l’océan de frontières imaginaires, mais plutôt des points d’accès qui faisaient l’objet de contestations et de négociations constantes. Mais la mer était ouverte à tout navigateur capable de la traverser.
C’est là le genre de monde qui a engendré des hommes et des femmes équipés de techniques et d’un courage qui leur a permis de se lancer dans l’inconnu, de découvrir et de peupler toutes les îles habitables à l’est du 130ème méridien. La renommée qu’ils ont acquise de façon posthume a peut-être été idéalisée, mais elle est solidement établie sur des exploits réels qui n’ont pu être accomplis que par des gens nés et élevés avec le grand large comme berceau et comme patrie.
Les impérialismes du dix-neuvième siècle ont élevé des frontières qui ont eu pour résultat le rétrécissement de l’Océanie, et transformé un monde autrefois sans limites en cette mosaïque d’états et de territoires insulaires que nous connaissons aujourd’hui. Les peuples ont été confinés dans leurs minuscules espaces, isolés les uns des autres. Ils ne pouvaient plus voyager librement pour faire ce qu’ils faisaient depuis des siècles. Ils étaient coupés de leurs familles établies dans d’autres archipels, de leurs lointaines sources d’enrichissement matériel et culturel. Voilà l’histoire qui fonde le point de vue selon lequel nos pays sont petits, pauvres et isolés. Il n’est vrai que dans la mesure où leurs populations sont encore parquées et mises en quarantaine.
Cette opinion n’est plus tenable en ce qui concerne les pays de Polynésie centrale et occidentale, et peut-être aussi la Micronésie. L’expansion rapide de l’économie mondiale dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre Mondiale a pu intensifier la dépendance du Tiers Monde, comme on l’a noté dans certaines hautes sphères universitaires, mais elle a eu aussi un effet libérateur sur les vies des gens ordinaires en Océanie, comme cela a aussi été le cas dans les Îles Caraïbes. La nouvelle réalité économique a rendues absurdes les frontières artificielles et permis aux gens de sortir de leur confinement. Depuis lors, ils se sont mis à voyager, par dizaines de milliers, à l’image de leurs ancêtres jadis, élargissant en chemin leurs perspectives sur le monde à une échelle impossible autrefois. Ils vont partout, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Hawaï, sur le continent nord-américain, aux USA et au Canada, en Europe et ailleurs, ils s’installent dans des régions aux ressources nouvelles, s’assurent des emplois et des terres familiales dans d’autres îles, élargissent les réseaux familiaux au sein desquels ils circulent eux-mêmes et font circuler leurs parents, leurs biens matériels et leurs histoires, d’un bout à l’autre de l’océan, et l’océan leur appartient car ils ont toujours été chez eux sur l’océan. Les tenants des sciences sociales peuvent bien dire de l’Océanie que c’est un Lac Espagnol, un Lac Britannique, un Lac Américain ou même un Lac Japonais. Mais nous savons tous que seuls ceux qui ont fait de l’océan leur home et qui l’aiment peuvent réellement en revendiquer la propriété. Les conquérants vont et viennent, l’océan reste, la mer océane est la mère de ses seuls enfants. Cette mer a d’ailleurs le cœur vaste : elle adopte tous ceux qui l’aiment.
Les ressources dont disposent les Samoans, les Tongiens, les Fidjiens, les Indiens de Fidji, les insulaires des Îles Cook, de Niue, de Tokelau, de Tuvalu, des Kiribati ne sont plus limitées à leurs frontières nationales. Elles se trouvent partout où ces gens-là vivent, de façon permanente ou pas, comme c’était le cas avant l’ère de l’impérialisme occidental. C’est une chose que l’on peut constater n’importe quand dans les ports et les aéroports de tout le Pacifique central, où l’on décharge autant d’envois venus de familles vivant ailleurs, que l’on charge de produits locaux pour les envoyer à l’extérieur. Matériaux de construction, machines agricoles, véhicules automobiles, marchandises lourdes, et une myriade d’autres choses arrivent, envoyées par des parents vivant à l’étranger, tandis que produits artisanaux, fruits et légumes tropicaux, kava, produits marins séchés et autres gourmandises quittent les îles natales. Bien que ce flot de marchandises ne soit généralement pas inclus dans les statistiques officielles, une grande partie du bien-être des gens ordinaires d’Océanie dépend de ces mouvements informels le long d’anciennes routes maritimes autrefois tracées en lignes et lignées de consanguinité, invisibles à ceux qui sont chargés d’appliquer les lois du confinement et de la mobilité contrôlée.
Le monde de l’Océanie n’est ni minuscule ni dépourvu de ressources. Il ne l’était que dans les conditions du confinement colonial qui dura moins d’un siècle dans une histoire de plusieurs millénaires. Les hommes ont, par nature, besoin d’espace pour se mouvoir librement, et plus l’espace est grand, mieux cela vaut pour eux. Les insulaires ont brisé la coquille de leur confinement, ils se promènent d’île en île, ils quittent leurs îles, moins à cause de la pauvreté de ces îles qu’à cause de ce confinement contre nature qu’ils ont subi, et qui les avait séparés de nombre de leurs sources de biens traditionnelles, et parce qu’ils ont la mobilité dans le sang. Ils sont de nouveau à même d’élargir leur monde, d’établir de nouvelles bases de ressources et d’étendre de nouveaux réseaux de circulation. Des alliances sont déjà en train de se forger entre un nombre croissant d’insulaires des archipels et les tangata whenua de Aotearoa (4), et il s’en forgera forcément d’autres avec les Polynésiens de Hawaï. Il n’est pas inconcevable que, si les Polynésiens arrivent un jour à s’unir, ils en viennent à revendiquer, sous une forme ou une autre, ces deux archipels, qui sont leurs deux plus grandes patries. Ils y ont déjà imposé leur présence, et y ont imprimé leurs marques de façon indélébile sur le paysage culturel.
Mais on ne peut distinguer clairement le processus esquissé ici quand on limite son attention à ce qui se trouve à l’intérieur des frontières nationales, et à ce qui se passe aux étages supérieurs de l’économie politique et de la diplomatie régionale et internationale. Ce n’est que lorsque l’on se concentre sur ce que les gens ordinaires font, en fait, plutôt que sur ce qu’ils devraient être en train de faire, que l’on obtient une image plus large de la réalité.
Le monde de l’Océanie ne comprend peut-être plus les cieux ni l’inframonde de la mythologie, mais il inclut à l’évidence les grandes cités d’Australie, de Nouvelle-Zélande, des États-Unis et du Canada. C’est à l’intérieur de ce monde élargi que l’étendue des ressources de ses peuples doit se mesurer.
De façon générale, les niveaux de vie en Océanie sont plus hauts que ceux de la plupart des sociétés du Tiers Monde. Attribuer ce fait uniquement aux aides et transferts de fonds – délibérément ou non interprétées comme des formes de dépendance envers les économies des pays riches – c’est malheureusement décoder de façon erronée la réalité contemporaine. Dans le Pacifique, les gens ordinaires, en ce qui concerne leur quotidien, dépendent infiniment plus d’eux-mêmes et de leurs parents au sens large, où qu’ils se trouvent, que des largesses de qui que ce soit, dont ils pensent en général qu’elles sont détournées par les élites dirigeantes. Les fonds et les marchandises que les insulaires de l’extérieur envoient à leurs familles dans leurs îles natales n’appartiennent qu’à eux-mêmes. Ils en gagnent chaque sou dans des emplois durs et éreintants, dans les villes qui ont besoin de leurs bras et les rémunèrent pour leur travail. Ils participent aussi à la fabrication de nombre de marchandises qu’ils envoient chez eux ; ils travaillent à la propreté des rues et des immeubles à Auckland, ils y contribuent aussi à la bonne marche des transports publics ; et si les banlieues des États-Unis de l’ouest (Hawaï inclus) sont propres, bien tenues, belles et vertes, c’est grâce à eux ; depuis des années ils font leur part dans infiniment plus de domaines qu’on ne l’a jamais reconnu.
D’autre part, les insulaires restés dans leurs îles ne sont pas ces parasites de leurs parents exilés que les dénigreurs des “transferts de fonds” voudraient nous faire croire. Les économistes ne prennent pas en compte le fait que la pratique de la réciprocité est au centre de la vie sociale insulaire, au cœur de toutes les cultures océaniennes. Ils omettent le fait que pour chaque envoi reçu par les familles restées dans l’île, repartent vers l’envoyeur des biens produits dans l’île, sont entretenues sur place les racines et les terres ancestrales de chacun, sauvegardés les foyers chaleureux vers lesquels les voyageurs reviendront, de façon permanente ou simplement pour raffermir leurs liens, leurs âmes et leurs identités avant de repartir. Il ne s’agit pas là de dépendance, mais d’interdépendance, ce qui est paraît-il l’essence même de la globalisation. Prétendre que c’est quelque chose d’autre et quelque chose de moindre n’est pas seulement faux, mais cela consiste à dénier à ces gens toute dignité.
Tout ce que j’ai dit jusqu’ici devrait avoir déjà fourni une réponse suffisante à l’assertion selon laquelle les îles sont isolées. De toute évidence, elles ne le sont pas. Grâce aux développements de la haute technologie, les systèmes de communication et de transport ont bénéficié d’améliorations immenses ces vingt dernières années. Il est vrai qu’ils coûtent très cher, quelle que soit la monnaie, mais ils sont disponibles et on les utilise. Les compagnies de télécommunications amassent des fortunes grâce aux interminables et haletantes conversations entre membres d’une même famille vivant à des milliers de kilomètres les uns des autres.
Mais les îles ne sont pas connectées seulement avec les régions riveraines du Pacifique. À l’intérieur de l’Océanie elle-même, les gens circulent à nouveau en nombres croissants, de plus en plus souvent. Des organisations régionales – intergouvernementales, éducatives, religieuses, sportives, et culturelles – sont en grande partie responsables de cette mobilité.
L’Université du Pacifique Sud (USP), avec son personnel extrêmement mobile, et sa population étudiante de jeunes gens venus des douze pays insulaires qui en sont propriétaires, mais aussi de pays extérieurs au Pacifique, en est un excellent exemple. De plus en plus, les anciens meneurs et moteurs des îles sont remplacés par de plus jeunes et, lorsqu’ils se retrouvent à Suva, Honiara, Apia, Vila ou n’importe quelle capitale du Pacifique, c’est en anciens de l’USP, en amis qui ont fréquenté les mêmes salles de cours, travaillé, joué et prié ensemble.
L’importance de notre océan dans l’équilibre de l’environnement sur toute la planète, la fourniture d’une proportion significative des besoins mondiaux en protéines, la production de certaines ressources marines dans des eaux encore relativement libres de pollution, et comme réserve globale de ressources minérales, entre autres, est de plus en plus incontestée, et met un terme à cette notion que l’Océanie est un désert économique. Lorsqu’on y ajoute nos zones économiques exclusives, les surfaces de la planète occupées par la plupart de nos pays insulaires ne peuvent plus être considérées comme « petites ». Vus sous cet angle, Kiribati, les États Fédéraux de Micronésie et la Polynésie Française, par exemple, comptent parmi les pays les plus vastes du monde. L’émergence d’organisations telles que le SPACHEE (South Pacific Action Committee for Human Environment and Ecology (5)), le SPREP (South Pacific Regional Environment Programme (6)), la FFA (Pacific Islands Forum Fisheries Agency (7)), et la SOPAC (South Pacific Applied Geosciences Commission (8)) ; l’émergence de mouvements pour un Pacifique sans nucléaire, pour la prévention du rejet des déchets toxiques, et pour l’interdiction des méthodes de pêche dites du « mur de la mort » (filets dérivants), mouvements qui ont des liens avec des mouvements et des organisations ailleurs dans le monde ; et l’instauration à l’USP de programmes de Sciences de la Mer et de Gestion des Ressources Océaniques, disposant de liens avec les pêcheries et les agences de ressources halieutiques dans tout le Pacifique et au-delà ; tout cela indique que nous pourrions jouer un rôle clé dans la protection et le développement durable de notre océan.
Il n’est pas de peuples sur terre mieux à même d’être les gardiens du plus grand océan du monde que ceux dont il est le berceau et la patrie depuis des générations. Bien qu’il s’agisse là d’un problème différent de ceux que j’ai traités depuis le début de cet essai, il fait partie de notre souci majeur : nous assurer un avenir infiniment meilleur que celui qui nous a été prédit et prescrit. Notre rôle dans la protection et le développement de notre océan n’est pas une mince affaire : ce n’est rien de moins qu’une contribution majeure au bien-être de l’humanité. Dans la mesure où cela nous fournirait le sentiment d’accomplir une tâche noble et nécessaire, nous devrions en saisir l’occasion sans tarder.
Les promoteurs de l’idée de « petitesse » à propos de l’Océanie ont fait remarquer fort justement la nécessité pour chaque état ou territoire insulaire d’adopter des formes appropriées de production spécialisée pour le marché mondial, d’améliorer leurs techniques de gestion et de commercialisation, etc. Mais ils se sont focalisés sur les activités limitées par les frontières nationales au niveau macroéconomique, à tel point qu’ils ont négligé ou minimisé la signification des autres processus que j’ai décrits ici et, ce faisant, évacué tout l’univers de nos us et coutumes et pratiquement tout notre potentiel d’autonomie. La raison en semble claire : d’une façon ou d’une autre, ils sont tous – ou presque tous – impliqués directement ou indirectement dans les domaines du développement assisté et de la géopolitique des pays riverains du Pacifique, dans l’intérêt desquels il est primordial de présenter l’immensité de notre monde comme un émiettement de fragments minuscules et nécessiteux. Reconnaître que la réalité est plus vaste consisterait à saper la vision prévalente et à frustrer les projets et les programmes de certains intérêts puissants. Ces promoteurs participent donc, comme je le faisais naguère, à la dépréciation de l’Océanie, et à la perpétuation des relations néocoloniales de dépendance qui se jouaient – et se jouent encore – dans les hautes sphères où évoluent politiciens nationaux, bureaucrates, diplomates et autres experts et universitaires, tandis que loin en-dessous d’eux on trouve cette autre humanité, celle des gens ordinaires, occupés en toute indépendance à redéfinir leur monde en fonction de ce qu’ils perçoivent comme étant leurs propres intérêts, pour que leurs enfants et les enfants de leurs enfants aient un avenir. Ceux qui maintiennent que les peuples d’Océanie vivent au jour le jour, sans vraiment se soucier des bénéfices à long terme, ignorent la vérité élémentaire que connaissent la plupart des gens nés dans les îles : à savoir qu’ils travaillent pour les générations à venir, pour la continuité et l’amélioration des conditions de vie de leurs familles et de leurs clans.
Tandis que je contemplais Big Island, la grande île de Hawaï, en train de surgir des profondeurs et de grandir, j’y ai vu l’avenir de l’Océanie, notre océan d’îles. Cet avenir est entre les mains de notre propre peuple, et non dans celles de ceux qui veulent nous dire quoi faire, nous maintenir éternellement dans la dépendance et les dettes parce qu’ils sont incapables d’imaginer autre chose.
À l’aéroport de Honolulu, en attendant mon vol de retour sur Fidji, j’ai rencontré un vieil ami, un Tongien qui fait le double de ma taille et vit à Berkeley, en Californie. Il n’a pas fait d’études. Il travaille à domicile, fait le jardinier, taille les haies et les arbres, émonde les charmilles et dégage les allées. Mais tous les trois ou quatre mois il prend l’avion pour Fidji, achète de huit à dix-mille dollars de kava, revient en Californie et le vend, chez lui. Il n’a jamais entendu parler de dépendance, et si on lui en parlait, cela n’aurait pas vraiment de signification pour lui. À Honolulu il m’a dit qu’il emportait une glacière pleine de T-shirts, dont certains pour les étudiants de l’université chez qui il loge souvent lorsqu’il se rend à Suva, et le reste pour sa famille à Tonga, où il va rester huit ou quinze jours, le temps que son kava soit récolté, moulu et mis en sacs à Fidji. Plus tard, il remplira la glacière de produits de la mer pour les remporter en Californie, où il a deux fils qu’il veut envoyer à l’université. À l’une de ses visites, il m’a aidé à rénover une maison que je venais d’acheter. Nous l’aimons bien parce que c’est un excellent conteur et qu’il n’est avare ni de son argent, ni de son temps, mais surtout parce qu’il est l’un des nôtres.
Il y en a des milliers comme lui, qui vont et viennent là-haut, survolant les frontières nationales, la ligne internationale de changement de date et l’équateur, loin au-dessus et parfaitement indifférents aux discours d’en bas – à leur sérieux mortel – sur la nature du Siècle du Pacifique, la sphère de coprospérité Asie-Pacifique, et les dispositions des riverains du Pacifique dans l’après-guerre froide ; des milliers qui cultivent leur univers éternellement en expansion à leur manière, à leur goût, et c’est bien ainsi, car c’est là que se trouve leur indépendance. Personne d’autre ne saurait la leur donner – nous la donner.
L’Océanie est vaste, l’Océanie est en expansion, l’Océanie est hospitalière et généreuse, l’Océanie c’est l’humanité qui surgit des profondeurs marines et des abîmes de feu plus profonds encore, l’Océanie c’est nous. Nous sommes la mer, nous sommes l’océan, il nous faut reprendre conscience de cette ancienne vérité et l’utiliser ensemble pour renverser tous les fantasmes hégémoniques dont le but ultime est de nous confiner à nouveau, physiquement et psychologiquement, dans les minuscules espaces que nous avons refusé de nous laisser imposer comme uniques demeures, et d’où nous nous sommes libérés il y a peu. Nous ne devons permettre à personne de nous déprécier à nouveau, ni de nous priver de notre liberté.
Notes de l’auteur :
J’aimerais remercier Marshall Sahlins d’avoir fini par me convaincre que tout n’était pas perdu, et que le monde de l’Océanie se porte bien malgré les apparences. Cet essai est basé sur des conférences données à l’Université de Hawaï, à Hilo, et à l’East-West Center, à Honolulu, en mars-avril 1993. Vijay Naidu et Eric Waddell ont lu un premier jet de cet essai et en ont fait des commentaires qui m’ont bien aidé. Je leur suis profondément reconnaissant pour leur soutien.
1 - Le terme « boy » était aussi utilisé aux Nouvelles-Hébrides (Vanuatu) où, jusque dans les années 1970, « les boys » pouvait signifier « les canaques » en général. En Indochine et en Afrique francophone, le terme était limité aux domestiques, et il avait même un féminin : « boyesse ». (NdT)
2 - En anglais : MIgration, Remittances, Aid and Bureaucracy. (NdT)
3 - Uvea est le nom indigène de Wallis (Wallis & Futuna), et de l’une des Loyautés de Nouvelle-Calédonie (Ouvéa), ce qui vient appuyer la thèse de Epeli Hau’ofa. (NdT)
4 - Les Maori de Nouvelle-Zélande. (NdT)
5 - SPACHEE : Comité d’action du Pacifique Sud pour l’Environnement Humain et l’Écologie.
6 - SPREP : Programme pour l’Environnement Régional du Pacifique Sud.
7 - FFA : Agence des Pêcheries du Forum des Îles du Pacifique Sud.
8 - SOPAC : Commission pour les Géosciences Appliquées dans le Pacifique Sud.

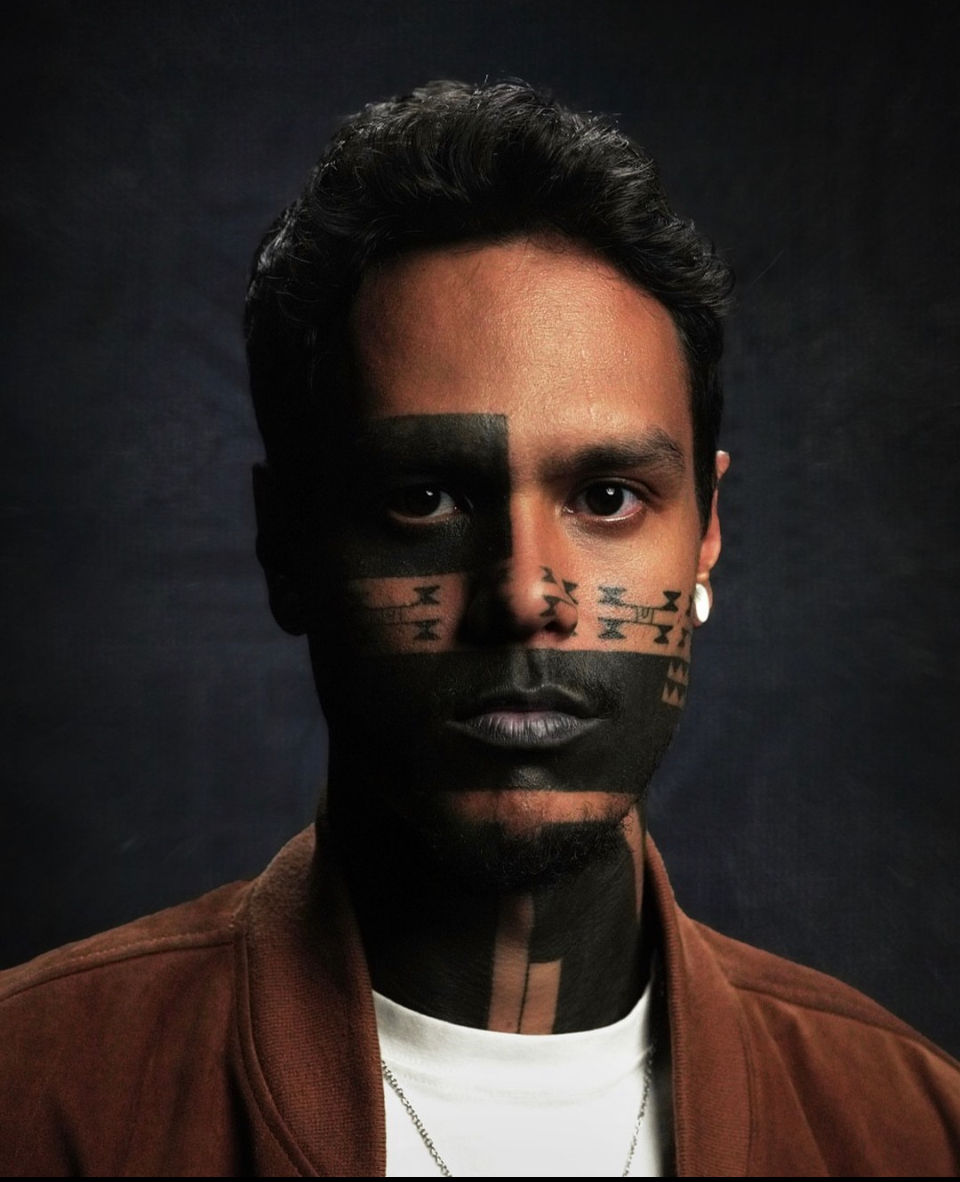

Commentaires