TRADUIRE CÉLESTINE
- 1 avr. 2023
- 9 min de lecture
Breadfruit, Bantam books, Vintage books 2000, L’Arbre à Pain, Au Vent des Îles, Papeete, 2003
par Henri THEUREAU
Ce devait être pendant l’année scolaire 2000-2001, il y a plus de vingt ans déjà, au Lycée des Îles-sous-le-Vent à Uturoa. Devant la cafetière électrique de la salle des profs, pendant la récré, un collègue angliciste me dit : « Tiens, j’ai une copine de France qui a gardé des contacts en Écosse, et elle m’a envoyé une coupure du Glasgow Herald à propos d’une romancière tahitienne qui écrit en anglais. » Intéressant. Il n’y avait pas très longtemps que j’avais un ordinateur, et donc je me lance à sa recherche sur internet : Célestine Vaite, un roman intitulé Breadfruit. Cette jeune femme, qui vit en Australie, raconte son enfance à Faa’a par le biais d’une héroïne appelée Materena, et son site publie un extrait du bouquin : c’est enlevé, drôle, dans un anglais un peu décalé, avec un personnage de mère de famille en butte aux tracas de l’administration aveugle et sourde.
À première lecture, il me paraît évident que l’auteur aurait dû écrire son livre directement en français, ce français légèrement créolisé, plein de tournures tahitiennes, le français qu’elle parlait enfant, à la maison, puisque son livre – que je me procure rapidement, toujours par internet – enchaîne les histoires de son enfance et de sa jeunesse à Faa’a et offre une galerie de personnages typés et assez réjouissants.

Je lui pose la question directement par mail, en lui envoyant la traduction du premier chapitre, et en précisant que je vis en Polynésie depuis une quinzaine d’années, que je suis marié à une Tahitienne de Raiatea, que j’ai déjà publié une dizaine de traductions de l’anglais chez Hachette Jeunesse, etc. Et je lui propose donc, si elle n’a personne d’autre en vue, de faire la traduction de Breadfruit. On verra plus tard si ça intéresse un éditeur de Tahiti, mais personnellement, je n’en doute pas un instant.
Et voilà, on ne pouvait pas faire plus simple. Pendant tout le travail de traduction nous avons correspondu par mail pour dissiper des ambiguïtés, éclaircir des situations, faire des choix de langage et de vocabulaire… Pour finir, après avoir envoyé mon manuscrit terminé à Célestine, je suis allé la voir un ou deux mois plus tard chez elle à Ulladulla, au sud de Sydney. Nous y avons travaillé une semaine entière, page à page, pour être sûrs de faire un travail qui soit cohérent pour chacun de nous deux. Puis j’ai porté la traduction « clés en main » chez Au Vent des Îles, qui a tout de suite été d’accord pour la publier.
La question : « Pourquoi ne l’a-t-elle pas écrit directement en français ? » a plusieurs réponses. Apparemment, Célestine avait écrit quelques nouvelles, – que l’on retrouve dans L’Arbre à pain – avant de partir vivre en Australie avec un beau surfeur. La réponse de l’éditeur à qui elle avait montré ses nouvelles ici avait été classique : « C’est pas mal, continuez et revenez nous voir quand vous aurez quelque chose de plus consistant. Et soignez votre français. » Une fois chez les kangourous, elle avait eu assez rapidement deux enfants, adieu la littérature, puis deux autres. Son mari ne parlant pas français elle avait, pour simplifier la vie de famille, fait le choix d’élever ses enfants en anglais. Après son troisième, sur un « coup de blues », un accès tardif de mal du pays, elle se remet à écrire. En anglais, car elle pense à une éventuelle édition en Australie, où ses petites histoires auraient le mérite immédiat de l’exotisme. Elle dit, d’ailleurs, qu’elle pense ses histoires en français mais les « traduit » directement en anglais.
Elle plonge dans ses souvenirs et en ramène toute sortes d’anecdotes, qui font autant de courtes nouvelles. Un ami d’amis lui offre d’en publier quelques-unes dans une revue universitaire. Les éditeurs anglo-saxons sont beaucoup plus habitués que les français à publier des textes peu « classiques ». Entre l’Angleterre, les États-Unis, l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l’Inde, la Jamaïque, l’Afrique du Sud… ils publient depuis fort longtemps des textes où l’anglais de la Reine (the Queen’s English, la référence) (1) est parfois malmené sans beaucoup d’égards. De toute façon, cela n’a pas grande importance : il n’existe pas d’Académie Anglaise veillant à la pureté de la langue. Un éditeur (Random House) lit la revue susdite, ça lui plaît, il invite Célestine à étoffer cette suite de « sketches » – en anglais, un sketch, c’est un croquis – et à prendre comme pivot le personnage de Materena, ce qui donnera une unité au livre et le rapprochera du format « roman ». Sitôt dit, sitôt fait, et c’est ainsi que Célestine se retrouve éditée, et bientôt recensée sur place par le Sydney Herald puis, aux antipodes, par le Glasgow Herald, et enfin… évoquée dans la salle des profs du Lycée de Uturoa.
***
Les problèmes de traduction de l’anglais australien qu’écrit Célestine n’avaient rien d’extraordinaire. Je possède plusieurs dictionnaires des différentes variantes nationales des argots utilisés par les anglophones, et puis je pouvais toujours faire appel à elle par mail si j’achoppais sur quelque chose. Donc, côté langue, pas de difficulté insurmontable. Côté environnement, j’avais fait un premier séjour à Raiatea au début des années 70, ce qui est approximativement la période dont parle Célestine. J’allais assez régulièrement à Papeete à cette époque, je connais de visu les lieux dont elle parle, donc, là aussi, pas de grande difficulté. Le français que parlent les Tahitiens entre eux, je le connais bien puisque je suis revenu dans les îles en 88 et que j’ai épousé une femme d’ici (et ses trois gosses) en 93 : le français de Célestine, c’est le français qu’on me parle à la maison.

Je me sens donc équipé pour ce travail, mais je me heurte rapidement à un problème véritablement littéraire. La trilogie qu’a écrite Célestine parle des choses de la vie et des relations humaines, voire de choses graves et entre autres de la progressive libération des femmes sur quatre générations. Mais on ne s’aperçoit de cela qu’au bout d’un certain temps. Lorsqu’on lit ses petites histoires, on rit souvent, et il est clair qu’elle écrit aussi pour faire rire. Et là, sa technique est complexe, voire multiple.
Elle utilise à merveille le comique de situation en décrivant sur un ton naïf des choses aberrantes – ou parfois simplement exotiques – qu’elle présente comme normales, voire banales. Mais sa naïveté est trompeuse : c’est souvent l’équivalent d’une attitude « pince-sans-rire », un des ressorts classiques du comique. Et puis, ses dialogues crépitent. On est dans le quotidien, les relations de voisinage, les relations familiales, ses personnages ont de la répartie. Célestine ne s’attarde jamais à décrire un décor ni un coucher de soleil. Elle est dans l’action, pas dans la contemplation.
Jean Anderson, traductrice néo-zélandaise, me disait à l’époque qu’elle trouvait à l’anglais de Célestine un charme « étranger », pour ne pas dire bizarre. Elle se demandait comment j’avais pu rendre compte de cela, de ce décalage entre l’anglais standard et l’anglais de Célestine, australien à intonations tahitiennes !
C’est là qu’on touche, je crois, au cœur du problème. Célestine entrelarde ses dialogues – et les passages narratifs ne sont bien souvent que des monologues intérieurs de Materena – d’expressions françaises qu’elle traduit directement en anglais : Final point pour « point final », qui se dirait full stop en anglais. Zero movie pour « film nul », qui se dirait peut-être crappy movie. Quand elle dit swearing birds’ names (traiter de noms d’oiseaux), elle prend soin de dire swearing, indiquant qu’il s’agit d’insultes et non pas d’ornithologie, car la métaphore aviaire est peu évidente pour le lecteur anglophone. Etc.
Il ne s’agit pas de néologismes, mais bien de calques du français, ou du franco-tahitien, destinés à accrocher l’oreille de son lecteur anglais et à le faire sourire. Quand elle écrit When chicken have teeth, voilà pour lui une expression totalement exotique et drôle. Si je la traduis par : Quand les poules auront des dents, ça ne fera rire aucun lecteur français. Si je traduis par Quand les cochons sauront voler, qui est son équivalent anglais, je suis à côté de la plaque puisqu’aucun Tahitien ne dirait jamais ça. Que faire, alors ?
Eh bien, j’utilise ce qu’on pourrait appeler la technique de compensation : s’il y a quelque chose dans le paragraphe qui peut donner lieu à un jeu de mots ou un gag qui s’intègre bien au contexte – ça arrive – je l’utilise, toujours avec prudence, pour tenter de compenser et de garder la même « densité » d’humour dans le paragraphe, ou dans la page. Je me souviens ainsi d’avoir traduit hypnotize par « hynoptiser » – faute classique chez mes élèves ici – parce que la phrase, le personnage et la situation s’y prêtaient. Dans l’ensemble, avec l’accord de Célestine, j’ai adopté la solution de traduire les dialogues dans le français un peu « périphérique » qu’on parle ici. Ce qui permet de donner un certain sel à des dialogues qui pourraient être banals, car l’anglais est souvent beaucoup plus « factuel » et donc plus « plat » que le français. Et puis le décalage avec le français « classique » rend souvent assez bien compte de cette fausse naïveté qu’elle utilise remarquablement.
La plus grande difficulté pour moi a certainement été de trouver le dosage idéal entre le parler local qu’on appelle ici le « charabia » (C’est joli pa’i à toi la robe ! – Eh, on a fait pour Noël, c’est ma mère = Elle est vraiment jolie, ta robe ! – Oui, c’est ma mère qui me l’a faite pour Noël) et le français standard. Le charabia à lui tout seul peut être parfaitement incompréhensible, d’autant plus qu’il est souvent entrecoupé d’exclamations, d’explétifs voire de phrases entières en tahitien. D’un point de vue linguistique, je pense qu’on est en train d’assister à la création d’une métalangue, d’un créole, en quelque sorte. (Avouerai-je que j’ai parfois du mal à comprendre ce que me dit mon épouse ? Mais il est vrai aussi qu’en vieillissant je deviens dur de la feuille.) J’avais donc l’impression d’être constamment sur une ligne de crête, en danger de tomber dans un français académique qui aurait été à contresens de l’anglais factuel et faussement naïf de Célestine, ou de dégringoler dans une métalangue qu’aucun lecteur français n’aurait comprise. (Ce qui est mon cas devant les clips de la télé locale intitulés Méga la blague…)
La deuxième difficulté a été, naturellement, de tenir cet « entre-deux » – ce style intermédiaire – d’abord tout le long de L’Arbre à Pain, qui fait quand même plus de 400 pages, puis sur les deux volumes suivants. Mais c’était un peu comme si, à chaque chapitre, il me suffisait de me remettre dans l’oreille les rafales de voyelles, les R roulés et les rires en cascade de ma famille tahitienne : au bout d’une ou deux pages, question de rythme aussi, ça revenait tout seul.
Après avoir terminé le premier jet de L’Arbre à Pain, je suis donc allé voir Célestine en Australie. Je lui avais envoyé mon manuscrit un mois avant, et elle l’avait soigneusement annoté. Nous avons travaillé pendant une dizaine de jours à reprendre tous les points qu’elle avait soulignés, mais je me souviens surtout de son plaisir à telle ou telle heureuse trouvaille, où elle s’écriait, avec son enthousiasme gratifiant (pour moi) : « Oui, c’est comme ça qu’on dit chez nous ! »
Il y eut un moment de gêne, après Tiare, le troisième. L’éditeur m’avait dit à demi-mot que Célestine trouvait que j’en faisais quand même un peu trop, côté charabia. Je n’ai pas pu en discuter avec elle, car elle était repartie – mais les trois livres avaient été primés, par des instances diverses, dont l’Association des Étudiants de P. F. – alors je me suis demandé si elle n’avait pas été abordée par quelques bonnes âmes en quête d’identité ma’ohi qui lui auraient fait reproche d’avoir confié à un vieux popa’a la tâche de faire parler leurs frères polynésiens, et en somme de s’être laissée vampiriser par un vieux colonial. Oui, il m’est arrivé de me faire traiter de vampire sur les fameux « réseaux sociaux ».
Ma foi, j’ai revu Célestine au Salon du Livre de novembre 2022. Nous ne nous étions pas revus depuis une dizaine d’années, qu’elle a en grande partie passées à s’occuper de sa fille aînée, victime d’un très grave accident. La façon dont elle m’a sauté au cou en public au Salon m’a rassuré. Vu le succès de la trilogie, qui se trouve maintenant en 10/18 dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre, je dois finalement faire un vampire assez présentable.
P.S. En fait, dès le début, il m’avait paru évident que cette suite d’histoires ou de scènes de la vie quotidienne autour du personnage de Materena ferait un feuilleton télévisé parfait. À l’époque, j’en avais parlé à l’éditeur, mais d’une part il avait d’autre soucis et d’autre part les chaînes de télévision – TNTV venait d’être créée – n’avaient ni la vocation ni le budget pour ce genre de choses. On en a reparlé récemment à l’occasion de la venue de Célestine au Salon du Livre de 2022. Tant mieux. J’espère que cela se fera. D’autant plus qu’avec les trois volumes de la trilogie, il y a de quoi filmer une véritable saga !

1 - Oui, je sais, la Reine est morte, vive le Roi ! Mais je n’arrive pas à m’y faire.

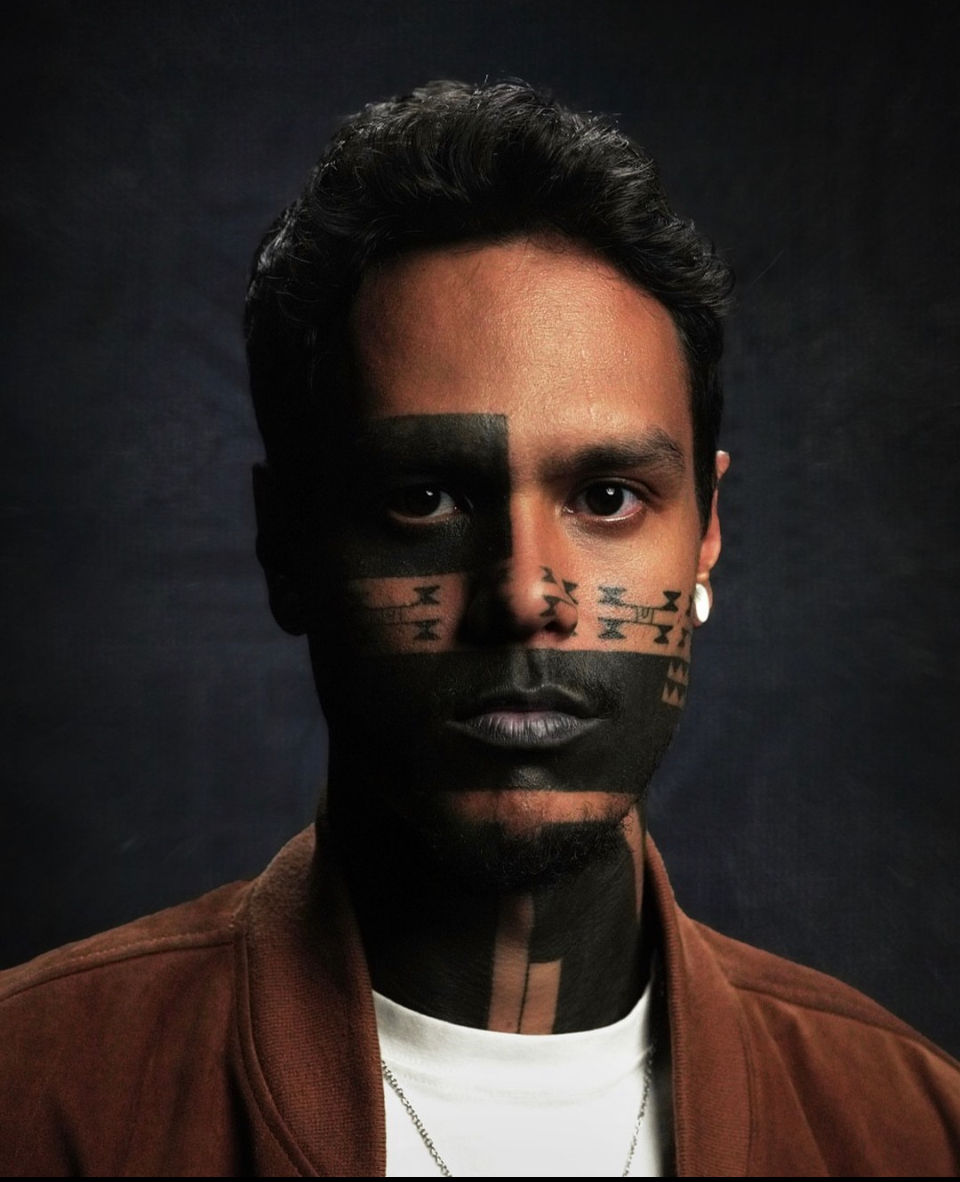

Commentaires